

L’argent va à l’argent. Serait-ce toujours le cas si les marchés fonctionnaient bien ?
Condorcet, dans son magnifique « Esquisse d'un tableau historique des progrès de l’esprit humain », écrit en 1794 quelques semaines avant d’être arrêté et que son destin en soit scellé, décrivait une tendance naturelle à l’égalisation des fortunes. Il fallait pour cela, indiquait-il, la suppression des privilèges, des inégalités de statut et des rentes de situation, c’est-à-dire le programme qu’il voyait pour la Révolution française. Il ajoutait, chose non négligeable, l’accès à l’éducation.
C’est cette tendance naturelle qu’on interroge ici. En formulant cette question immense de façon bien plus étroite : observerait-on une réduction spontanée de l’inégalité des patrimoines dans une économie idéalisée où le marché fonctionnerait de bonne façon ? Par bon fonctionnement, on entend ici, presque comme Condorcet, un marché où les règles de concurrence sont respectées, où les rentes créées et maintenues par des monopoles ou barrières à l’entrée n’existent pas, où l’information circule parfaitement entre les acteurs et où les lois sont respectées, notamment celles portant sur le respect des contrats. On se met aussi dans une situation hautement fictive où les talents et l’éducation sont les mêmes pour tous, de sorte que le marché ne peut avantager celui qui a des avantages naturels ou acquis dans sa jeunesse : une belle allure pour celui qui veut être mannequin ; un don pour le codage pour celle qui postule chez Google. Ainsi, on suppose que les individus, dotés du même « capital humain », ne diffèrent que par le patrimoine de départ, quels qu’en soient l’origine, legs ou chance.
La question devient : un tel marché concurrentiel a-t-il tendance à résorber ou à accroître ces inégalités sur la durée ?
La réponse donne lieu à controverse. On reconnaît en général qu’un tel marché ouvre des opportunités à tous parce qu’il fait disparaître les barrières de statut ou de rente et permet un anonymat propice à limiter les sujétions au pouvoir d’autrui. L’arbitrage continuel sur les prix et les rémunérations qu’impose la concurrence a un perpétuel effet égalisateur. Le système des prix et des rémunérations fournit en général de bonnes incitations à mettre ses talents en œuvre pour davantage de production et de richesse. Enfin et surtout, le marché est un moyen efficace et peu coûteux de coopérer avec les autres. Si je désire un bien que d’autres gens veulent, le prix s’élève et je dois trouver chez les autres, par les services que je leur rends, les ressources nécessaires à l’obtenir. Ainsi mes choix m’imposent, de façon impersonnelle, de tenir compte des coûts et avantages de ces choix pour les autres. D’où les notions d’égalité et de liberté des parties dans l’échange qu’on entend souvent mettre en avant.
Malgré cela, on répond ici que le marché accroit les inégalités. Pour dire les choses simplement, l’argent va à l’argent. Quatre raisons à cela.
- La richesse, ce sont des actifs détenus en propre, et donc une capacité à mettre des actifs en gage pour obtenir du crédit. Ce sont par conséquent aussi des fonds propres, qui facilitent également l’accès au crédit. On profite ainsi d’un triple avantage : saisir les opportunités d’affaires, l’effet de levier et l’effet de croissance. L’effet de levier veut dire que le rendement des actifs est plus fort que le coût du crédit, permettant au détenteur des fonds propres de mettre la différence dans sa poche ; l’effet de croissance, que le taux de croissance de l’économie est assez souvent supérieur au coût du crédit, de sorte que la dette le plus souvent « se rembourse toute seule »[1]. On voit ces trois effets à l’œuvre quand on compare le sort du propriétaire et du locataire de son logement.
- La richesse, c’est un effet de levier sur le capital humain. Principalement, elle donne les moyens d’économiser de son temps personnel en sous-traitant auprès de tiers les tâches à plus faible productivité (tâches domestiques en particulier) ou les tâches pour lesquelles il faut un temps d’apprentissage long. Elle permet de rentrer dans des contrats de travail en étant du côté de l’employeur, rémunérant le capital humain comme il le fait du crédit obtenu, à savoir par une rémunération fixe et non liée aux résultats. À l’autre extrême en termes de richesse, on voit la personne démunie consommer son temps en des tâches à faible productivité, ou qu’elle pourrait éviter si elle avait normalement accès aux différents marchés de biens et services. Il suffit de mentionner le non-accès à la carte de crédit, qui oblige la personne à aller chercher son argent à La Poste ; ou à l’assurance-santé qui empêche la personne de développer tout son potentiel[2].
- La richesse permet l’auto-assurance, et donc une capacité à absorber un grand nombre de chocs et à diversifier les risques. On économise ainsi les coûts d’intermédiation de l’assurance privée.
- La richesse permet de prendre plus de risques, et le risque est rémunérateur sur la durée. Un résultat classique en finance est ce qu’on appelle l’equity puzzle, qui indique que l’investissement en actifs risqués, dont les actions, dont l’entreprise, rapporte davantage que ce que voudrait une rémunération normale du risque. Certains jeux de société, comme le poker ou au bout de quelques tours le Monopoly (qui est malgré son nom un jeu où la concurrence est respectée), en donnent une idée intuitive.
On pourrait répondre que ces cas ne sont souvent que le symptôme de marchés non concurrentiels ou incomplets. Un pur marché du crédit permettrait à tous l’accès au crédit, par des procédures de mutualisation ; même chose pour certains marchés de l’assurance. Mais cette réponse ne tient pas : les coûts de transaction et d’information nécessaires au bon fonctionnement de tels marchés les rendent non viables en pratique pour les gens à faibles moyens. Soutenir une approche pro-marché dans ces domaines relève en l’état actuel des techniques et pour longtemps de l’idéologie.
D’autant qu’un cinquième facteur intervient alors qu’il repose quant à lui sur un parfait mécanisme de marché.
- Le marché discrimine selon les biens. Quand deux personnes de ressources différentes viennent sur un marché dont le prix est par définition unique, la personne à haut revenu est toujours capable de mettre « plus » pour acquérir le bien. Autrement dit, elle achète toujours un bien de base à un prix inférieur à son prix de réserve, tandis que la personne à faibles moyens achète toujours à un prix proche de son prix de réserve. Un marché concurrentiel fabrique automatiquement de larges surplus – la différence entre prix de marché et prix de réserve – pour ceux qui ont beaucoup d’argent. Les gens pauvres ne profitent de tels surplus que pour les produits réellement banals, tels que le sel, le pain, l’eau courante ou la pomme de terre. On reconnait dans ce mécanisme le débat très actuel sur la consommation « contrainte » et la consommation libre. Disposant d’un large accès à une consommation libre qui comporte des biens comme la santé, la culture, les loisirs ou l’éducation, la personne aisée en retire un avantage de productivité, pour elle ou ses enfants, qui renforce sa richesse.
Ainsi, malgré les mérites à reconnaître à une économie de marché fonctionnant bien, avec de bonnes institutions et de bonnes règles de concurrence, voici au moins cinq forces qui accroissent en général les inégalités de richesse. On verra donc les longues périodes de paix et de stabilité politique coïncider, au bout d’un certain temps, avec une inégalité croissante de la richesse. C’est une telle période de paix qui s’est ouverte en Europe au sortir des guerres napoléoniennes ; c’est une autre de ces périodes que l’on connait depuis la fin des deux guerres mondiales – qui n’en ont été qu’une seule. Cette tendance lourde à l’inégalité s’ajoute à d’autres sources d’inégalités qu’on voit particulièrement à l’œuvre dans des périodes de forte innovation technique, comme celle que l’on vit en ce moment : la prime donnée à l’éducation et au talent, dans une économie mondialisée et numérique, est bien plus forte que dans des périodes plus stables, où le progrès technique est moindre et où ce sont les inégalités de position et de patrimoine qui l’emportent, avec renfort mutuel et incrustation des phénomènes de caste.
Ce court développement a des conséquences claires en matière de politique économique et sociale, si la société compte parmi ses objectifs de limiter des disparités trop fortes de richesse. Elle ne peut se limiter à une politique de réglementation pro-concurrentielle, si importante que soit cette fonction. Elle doit y ajouter ou renforcer toujours deux autres classes d’instruments :
- Introduire des mécanismes de solidarité en sus des mécanismes concurrentiels, contrevenant à la règle de fixation du prix ou du revenu selon le jeu normal du marché. L’assurance-santé ou vieillesse ne peut fonctionner de façon politiquement acceptable qu’avec des mécanismes redistributifs ; le marché de l’éducation pareillement ; celui du travail aussi avec des réglementations comme le salaire minimum ou un poids institutionnel plus fort donné à la partie salariale. C’est pour cette raison que sont apparues les subventions aux biens ou même leur gratuité comme instruments de redistribution. Le logement, les loisirs, la culture, etc. en sont des exemples. On rejette ici le raisonnement néo-classique selon lequel il faut privilégier une action sur les revenus plutôt que sur les prix relatifs en matière de redistribution.
- Limiter la force du droit de propriété, principalement par le jeu de la politique fiscale : sur l’héritage et les transferts d’actifs, sur le revenu, sur la consommation, sur le capital. Or, le système fiscal comporte de nombreux biais qui favorisent la richesse, comme par exemple l’avantage donné à la forme juridique de société pour contracter de la dette ou se mettre en faillite, la non-taxation des autoproductions, au premier rang desquelles le service de logement que se rend gratuitement le propriétaire de son logement, la sous-taxation des revenus du capital, etc.
Manier ces deux sujets est au cœur du débat démocratique.
[1] Dans un papier récent, deux économistes du FMI, Paolo Mauro et Jing Zhou, montrent qu’en effet, sur un vaste échantillon de pays et sur plus de 200 ans, le taux de croissance de l’économie a dépassé le taux d'intérêt réel plus de 60 % du temps. [2] C’est ce que montre Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo (« Repenser la pauvreté », Seuil, 2011) : le pauvre est autant pauvre en temps qu’en argent.
















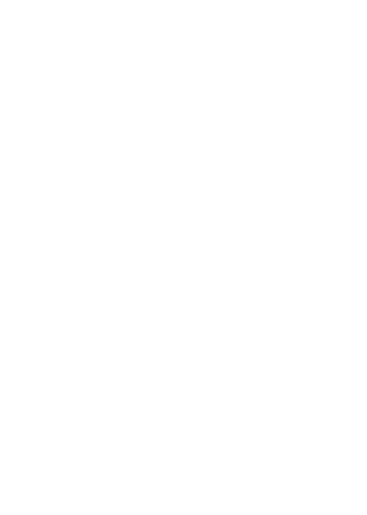
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.