
Liste des articles


Vue 342 fois
19 juin 2019
Notes de lecture : « La science de la richesse. Essai sur la construction de la pensée économique » de Jacques Mistral *
Publié par
Francois Meunier
| Dans les rayons
Cet article a été initialement publié sur le site voxfi.fr, le 20 mai dernier.
Il faut une bonne dose de muscle, d’aplomb et de culture pour entreprendre un livre économique d’une telle envergure : « La science de la richesse. Essai sur la construction de la pensée économique », Gallimard, 2019. Le résultat est là : voici un ouvrage désormais incontournable dans le domaine, large, de la genèse des idées économiques.
Il est lumineusement écrit, avec le respect des deux règles de base pour celui qui se risque à écrire en histoire des sciences : montrer la problématique de l’auteur en relation avec son temps ; tout en posant le regard moderne et critique sur ce qui est énoncé par l’auteur, permis par l’évolution à aujourd’hui de la discipline. C’est ce qui fait que le public potentiellement intéressé par le livre me paraît large : au premier chef, les enseignants de la discipline, en lycée ou à l’université, les étudiants en économie, mais au-delà toute personne qui s’intéresse à l’économie et à la vie sociale. Seule réserve pour ce dernier public, on profite d’autant mieux de la lecture qu’on dispose déjà d’un vernis assez épais en matière d’économie. Mais ce n’est qu’un compliment de plus : il y a plusieurs niveaux de lecture et plusieurs portes d’entrée dans le livre. Attendez-vous quand même à quelques bonnes soirées de lecture pour l’ingérer tout à fait.
Dans les quelques domaines où, à force de besogne, je crois avoir acquis une petite compétence, notamment en finance d’entreprise ou, souvenir de jeunesse, en économie marxiste, voici que vient sous la lecture une synthèse claire et nette. Les connaisseurs d’autres domaines doivent réagir pareillement.
À saluer d’entrée une saine innovation de langage. On use communément du mot « science économique » ou bien, en protestation contre la scientificité parfois pompeusement revendiquée de la discipline, celui d’ « économie politique ». Mistral propose de revenir au vieux mot d’« économique », plus modeste et qui évite les postulations d’emblée. Après tout, on dit bien « la physique » ou « les mathématiques », et on ne dit pas la « science psychologique » ni la « psychologie politique ».
De façon délibérée, Mistral intitule son livre « essai » et non le classique « Histoire de la pensée économique », alors qu’on pourrait assurément comparer son livre aux deux classiques du genre que sont « Le Blaug » et « Le Schumpeter ». Il y a peut-être une part de réserve chez l’auteur ; peut-être aussi une commodité : un essai a le droit de ne pas être exhaustif et de laisser quelques trous. Mais il y a une raison plus importante qui est l’approche suivie au fil du livre : la production des idées économiques est intimement reliée à l’histoire politique, institutionnelle, culturelle de l’époque où elles naissent, domaine où Mistral imprime sa propre vision.
Ainsi du choix de dater de la Renaissance la genèse de cette discipline (ce qui implique de laisser dans l’ombre l’Antiquité et la période scolastique, pourtant des périodes riches en problématiques économiques). Il en donne la raison : c’est à cette date, autour du 16ème siècle, qu’il s’est débloqué quelque chose, à savoir des sociétés prenant progressivement conscience de l’autonomie de l’individu et du droit à la critique sociale. On écarte les éléments transcendants dans l’explication sociale et, dans cette reconfiguration, dans cette réflexion sur elle-même, la société fait naître conjointement la philosophie politique et la réflexion économique, chacune d’elles allant progressivement devenir des disciplines à part entière.
À l’école, on use d’une date pour résumer ce qu’est l’histoire : 1515, Marignan !, ce qui est faire beaucoup d’honneur à cette bataille à l’enjeu médiocre. Mais qu’on songe à ce qui s’est passé autour d’elle (p. 56 du livre) : 1513, Copernic expose son système ; 1513 : Machiavel publie Le Prince ; 1516 : Thomas More publie L’Utopie ; 1517 : Luther affiche ses 95 thèses. Et quelques années avant : 1492, imprimerie ; et découverte de l’Amérique, ce qui a été un choc politique et économique immense, bouleversant la carte de l’Europe, comme allait le faire un peu plus tard la Réforme. Au 16ème siècle donc, c’est une société nouvelle qui se regarde et qui a besoin d’instruments en matière de pensée politique et d’économique.
Il est aisé de poursuivre avec Mistral : le 17ème siècle (en fait jusqu’à 1750) arrive et avec lui le mercantilisme (associé en France au nom de Colbert), qui nous vaut un remarquable chapitre du livre. La discipline économique se tourne vers la notion clé de richesse de l’État, et donc de levée d’impôt, de contrôle de la monnaie, de commerce extérieur devenu l’enjeu d’âpres batailles entre pays. Or, le mercantilisme, loin d’être la caricature qu’on en fait d’une doctrine exaltant médiocrement le protectionnisme et la thésaurisation de l’or, est l’affirmation par les idées de ces États nationaux en cours de constitution. Si l’or les intéresse tant, c’est parce qu’il permet d’établir leur puissance. Cela implique de lourds investissements pour conquérir les marchés étrangers et ne pas laisser l’ « ennemi » s’emparer du sien. Il fallait notamment récupérer les richesses venues d’Amérique accumulées par l’empire des Habsbourg en Espagne. Le mercantilisme, c’est l’idéologie économique dont a besoin le monarque. Et parallélisme à nouveau entre la pensée politique et économique. Par exemple, la pensée libérale de ce siècle nait, c’est évident chez Hobbes, du souci de donner une légitimité politique à l’ordre qui tentait de s’installer à l’occasion de la Révolution anglaise ; et le mercantilisme en donne le volet économique.
La fin du 18ème siècle voit quant à elle la naissance de l’école classique, associée notamment aux noms de Turgot (1767), Smith (1776) et plus tard Ricardo (1817). C’est la naissance du libéralisme économique, indissociablement lié au libéralisme politique. Le Monarque n’est plus de mise, n’étant plus le pivot obligé de la richesse du pays. Le capitalisme s’installe et avec lui sa dynamique de développement autonome. Pour les nouveaux marchands qui imposent leurs vues au pouvoir politique, il y a trop à perdre à se priver d’opportunités d’échanges à l’international, d’où, entre autres choses dans le bouleversement intellectuel de l’époque, les éléments d’une théorie du libre-échange.
De mon point de vue, le chapitre qui traite d’Adam Smith est remarquable. C’est une figure nouvelle de lui qui apparaît, celle d’un grand philosophe des Lumières écossaises, loin de la sotte lecture (si même on le lit) qu’on fait de cet auteur. Non, il n’est pas le théoricien d’un ordre spontané de marché, conduit par une sorte de « main invisible » (une expression ultracélèbre mais qui veut dire pour Smith tout autre chose que le slogan qu’on répète aujourd’hui). Non, il n’est pas le chantre de l’intérêt individuel conduisant miraculeusement à l’intérêt collectif (la fable du boucher) : le concept de « sympathie » est pour lui tout aussi important que celui d’intérêt individuel. Non, il n’est pas le théoricien de la valeur-travail, une théorie reprise et développée par Ricardo et surtout Marx (avec les impasses auxquelles cela a conduit), mais dont, par préscience, il s’écarte prudemment.
Un très bon chapitre aussi sur Marx qui ronge assez sérieusement la cohérence de la pensée économique de Marx, mais d’où le lecteur sort un peu surpris : pourquoi alors, dans le reste de l’ouvrage, faut-il le glorifier à ce point en tant que visionnaire ? Pour Marx, la théorie de la valeur et de l’exploitation était le socle économique de sa compréhension sociale. Si cette théorie flanche, alors les dégâts à l’édifice sont beaucoup plus sérieux que l’entend Mistral. Le lecteur reste toujours fasciné par les analyses historiques de Marx, mais n’est pas convaincu qu’il arrive à intégrer pleinement la dynamique historique à son raisonnement économique ; il s’agit souvent plutôt d’un collage, d’une juxtaposition. C’est peut-être au fond sa théorie de la croissance (ou de la reproduction, dans ses termes) qu’il faut conserver parce qu’elle était novatrice.
Bien entendu, la théorie néoclassique y trouve bonne place, surtout Walras et la notion d’équilibre, de fonctionnement des marchés, qui ouvre le champ à la microéconomie et aux instruments qu’elle a permis de construire. Cette théorie rebute souvent parce qu’on la réduit à tort à une explication à partir de l’utilité égoïste de la personne. C’est faux, même si certains en usent quasiment de façon religieuse. Mistral dit bien qu’à en rester là, « l’économiste a peu de chances de nouer un dialogue fructueux [avec les autres sciences morales] si sa contribution à l’examen des conduites sociales se limite depuis les origines à cultiver un éloge sophistiqué de l’égoïsme et du profit » (p. 152)
La confrontation toujours renouvelée entre les « classiques » et les « néo-classiques » reste un élément qui vivifie la discipline : « On doit donc s’attendre à ce que la pensée économique s’interroge à la fois sur les lois de structure qui gouvernent […] la croissance, les crises, le chômage, les inégalités ; et sur les mécanismes présidant à la coordination d’une multitude de décisions décentralisées portant sur les produits, les coûts, la tarification des services publics, les choix d’investissement. » (p. 82) Même au travers de ses errements, la discipline économique a réussi à construire des outils d’analyse qui trouvent leurs applications dans la politique économique et fiscale, l’évaluation, la conduite des entreprises, pour citer quelques domaines.
Une petite critique, qui s’adresse surtout à Gallimard qui publie l’ouvrage et qui a sans doute pris au mot Mistral sur le terme d’« essai » qu’il emploie : il manque cruellement un index des noms propres utilisés et un récapitulatif bibliographique. Le lecteur est obligé de barbouiller de notes son livre pour s’y retrouver. Gageons que la prochaine édition y remédiera, ou les traductions en langue étrangère qui ne sauraient tarder. (Les éditeurs français, même les plus prestigieux, sont assez paresseux sur les ajouts bibliographiques.)
Il y a différents niveaux de discours en matière de connaissance. Au niveau le plus assuré, cas des sciences de la nature, il y a accumulation directe de connaissances et le propre d’une science est alors de devenir anonyme. Rien ne sert de lire Lavoisier dans le texte d’origine pour connaître l’oxygène, ni Newton pour comprendre la chute des corps. Un manuel de 1er cycle universitaire le fait beaucoup mieux que les auteurs d’origine, à force d’avoir été enseigné des milliers de fois.
La philosophie est le niveau le moins assuré. Tout étudiant en philo lit et relit Platon, Spinoza et les autres. On se frotte au texte ou aux commentaires du texte pour poser en termes modernes la réflexion. L’accumulation de connaissances n’est pas comme un mur qu’on construit, mais un perpétuel va-et-vient. Le texte religieux va plus loin encore : sa richesse vient de son ambiguïté. Thomas d’Aquin disait « Si le Christ avait consigné par écrit sa doctrine, les hommes penseraient que son enseignement ne recèle rien de plus profond que la formule écrite », d’où, ajoute-t-il, que chez les païens aussi, Pythagore et Socrate, qui furent les plus remarquables des docteurs, n’ont rien voulu écrire.
Eh bien, l’économique est un peu entre les deux. On peut être un bon économiste sans avoir lu dans le texte Smith et Keynes. Mais en général les grands économistes d’aujourd’hui l’ont fait, même si les manuels modernes les résument assez bien. Il reste le besoin de se réclamer d’un grand auteur et de l’interpréter, y compris dans son ambiguïté. Un exemple : le génial chapitre 12 de la Théorie générale de Keynes où il parle de la formation des anticipations et de l’incertain en économie : des gens sérieux ont dépensé le gros de leur vie universitaire à gloser et ratiociner sur ce chapitre, preuve qu’il touche un vrai problème, mais probablement mal posé encore. Bref, il y a donc une partie « anonyme » de connaissances qui s’additionnent (on sait désormais ce qu’est l’effet d’une taxe, d’un tarif, etc.) et une partie qui est davantage circulaire, qui aide à organiser la pensée, à renouveler un débat, etc. Comme en philosophie, des questions reviennent de façon récurrente, avec les mêmes lignes de fracture entre économistes (exemple : le SMIC aide-t-il l’emploi ? L’État doit-il s’endetter ?) Certains désignent cette seconde partie par le terme d’idéologie, et pourquoi pas ? Car ce peut être de la bonne idéologie si les économistes conduisent le débat en s’accordant sur les règles de raisonnement. Il n’y a pas en économie des lois fixes qu’il conviendrait d’expliquer au mieux comme on le fait pour la chute des corps. La mise en contexte historique s’impose pour bien comprendre comment telle proposition a pu émerger, et dans quel contexte moderne elle émerge à nouveau. L’historien des idées n’a donc rien d’un antiquaire remuant la poussière. Dans cette réalité dont la complexité nous nargue et qui nous interdit de faire de l’expérimentation comme dans les sciences dures, on arrive à déceler certaines familles de problématiques et, par commodité, y rattacher un étendard, souvent le nom d’un grand penseur. Il y a alors un enjeu bien sûr scientifique, mais aussi idéologique, à ce que l’étendard soit le bon, qu’il n’y ait pas captation intellectuelle par quelqu’un qui voudrait attacher à ses propres convictions le « goodwill » du nom prestigieux (ainsi, nous dit Mistral, des néolibéraux qui ont opéré un rapt sur Adam Smith). Le monde il y a un quart de siècle était largement keynésien, croyant fortement à la régulation et à l’intervention de l’État après les chocs des grands conflits mondiaux. Puis, les économistes ont majoritairement basculé vers une approche « néolibérale », en partie sous l’effet de chocs technologiques qui ont semblé donner une prime aux pays choisissant la flexibilité la plus grande. Ayant sous les yeux certaines des conséquences de ce choix, on rebascule en ce moment vers une réappréciation du rôle de l’État et du bien commun. À voir. Mais, pendant ce temps, l’économique poursuit sa « demi »-accumulation de connaissances.
Cela ajoute plus qu’une demi-raison de lire Mistral.
« La science de la richesse. Essai sur la construction de la pensée économique » de Jacques Mistral, aux éditions Gallimard
Il faut une bonne dose de muscle, d’aplomb et de culture pour entreprendre un livre économique d’une telle envergure : « La science de la richesse. Essai sur la construction de la pensée économique », Gallimard, 2019. Le résultat est là : voici un ouvrage désormais incontournable dans le domaine, large, de la genèse des idées économiques.
Il est lumineusement écrit, avec le respect des deux règles de base pour celui qui se risque à écrire en histoire des sciences : montrer la problématique de l’auteur en relation avec son temps ; tout en posant le regard moderne et critique sur ce qui est énoncé par l’auteur, permis par l’évolution à aujourd’hui de la discipline. C’est ce qui fait que le public potentiellement intéressé par le livre me paraît large : au premier chef, les enseignants de la discipline, en lycée ou à l’université, les étudiants en économie, mais au-delà toute personne qui s’intéresse à l’économie et à la vie sociale. Seule réserve pour ce dernier public, on profite d’autant mieux de la lecture qu’on dispose déjà d’un vernis assez épais en matière d’économie. Mais ce n’est qu’un compliment de plus : il y a plusieurs niveaux de lecture et plusieurs portes d’entrée dans le livre. Attendez-vous quand même à quelques bonnes soirées de lecture pour l’ingérer tout à fait.
Dans les quelques domaines où, à force de besogne, je crois avoir acquis une petite compétence, notamment en finance d’entreprise ou, souvenir de jeunesse, en économie marxiste, voici que vient sous la lecture une synthèse claire et nette. Les connaisseurs d’autres domaines doivent réagir pareillement.
À saluer d’entrée une saine innovation de langage. On use communément du mot « science économique » ou bien, en protestation contre la scientificité parfois pompeusement revendiquée de la discipline, celui d’ « économie politique ». Mistral propose de revenir au vieux mot d’« économique », plus modeste et qui évite les postulations d’emblée. Après tout, on dit bien « la physique » ou « les mathématiques », et on ne dit pas la « science psychologique » ni la « psychologie politique ».
De façon délibérée, Mistral intitule son livre « essai » et non le classique « Histoire de la pensée économique », alors qu’on pourrait assurément comparer son livre aux deux classiques du genre que sont « Le Blaug » et « Le Schumpeter ». Il y a peut-être une part de réserve chez l’auteur ; peut-être aussi une commodité : un essai a le droit de ne pas être exhaustif et de laisser quelques trous. Mais il y a une raison plus importante qui est l’approche suivie au fil du livre : la production des idées économiques est intimement reliée à l’histoire politique, institutionnelle, culturelle de l’époque où elles naissent, domaine où Mistral imprime sa propre vision.
Ainsi du choix de dater de la Renaissance la genèse de cette discipline (ce qui implique de laisser dans l’ombre l’Antiquité et la période scolastique, pourtant des périodes riches en problématiques économiques). Il en donne la raison : c’est à cette date, autour du 16ème siècle, qu’il s’est débloqué quelque chose, à savoir des sociétés prenant progressivement conscience de l’autonomie de l’individu et du droit à la critique sociale. On écarte les éléments transcendants dans l’explication sociale et, dans cette reconfiguration, dans cette réflexion sur elle-même, la société fait naître conjointement la philosophie politique et la réflexion économique, chacune d’elles allant progressivement devenir des disciplines à part entière.
À l’école, on use d’une date pour résumer ce qu’est l’histoire : 1515, Marignan !, ce qui est faire beaucoup d’honneur à cette bataille à l’enjeu médiocre. Mais qu’on songe à ce qui s’est passé autour d’elle (p. 56 du livre) : 1513, Copernic expose son système ; 1513 : Machiavel publie Le Prince ; 1516 : Thomas More publie L’Utopie ; 1517 : Luther affiche ses 95 thèses. Et quelques années avant : 1492, imprimerie ; et découverte de l’Amérique, ce qui a été un choc politique et économique immense, bouleversant la carte de l’Europe, comme allait le faire un peu plus tard la Réforme. Au 16ème siècle donc, c’est une société nouvelle qui se regarde et qui a besoin d’instruments en matière de pensée politique et d’économique.
Il est aisé de poursuivre avec Mistral : le 17ème siècle (en fait jusqu’à 1750) arrive et avec lui le mercantilisme (associé en France au nom de Colbert), qui nous vaut un remarquable chapitre du livre. La discipline économique se tourne vers la notion clé de richesse de l’État, et donc de levée d’impôt, de contrôle de la monnaie, de commerce extérieur devenu l’enjeu d’âpres batailles entre pays. Or, le mercantilisme, loin d’être la caricature qu’on en fait d’une doctrine exaltant médiocrement le protectionnisme et la thésaurisation de l’or, est l’affirmation par les idées de ces États nationaux en cours de constitution. Si l’or les intéresse tant, c’est parce qu’il permet d’établir leur puissance. Cela implique de lourds investissements pour conquérir les marchés étrangers et ne pas laisser l’ « ennemi » s’emparer du sien. Il fallait notamment récupérer les richesses venues d’Amérique accumulées par l’empire des Habsbourg en Espagne. Le mercantilisme, c’est l’idéologie économique dont a besoin le monarque. Et parallélisme à nouveau entre la pensée politique et économique. Par exemple, la pensée libérale de ce siècle nait, c’est évident chez Hobbes, du souci de donner une légitimité politique à l’ordre qui tentait de s’installer à l’occasion de la Révolution anglaise ; et le mercantilisme en donne le volet économique.
La fin du 18ème siècle voit quant à elle la naissance de l’école classique, associée notamment aux noms de Turgot (1767), Smith (1776) et plus tard Ricardo (1817). C’est la naissance du libéralisme économique, indissociablement lié au libéralisme politique. Le Monarque n’est plus de mise, n’étant plus le pivot obligé de la richesse du pays. Le capitalisme s’installe et avec lui sa dynamique de développement autonome. Pour les nouveaux marchands qui imposent leurs vues au pouvoir politique, il y a trop à perdre à se priver d’opportunités d’échanges à l’international, d’où, entre autres choses dans le bouleversement intellectuel de l’époque, les éléments d’une théorie du libre-échange.
De mon point de vue, le chapitre qui traite d’Adam Smith est remarquable. C’est une figure nouvelle de lui qui apparaît, celle d’un grand philosophe des Lumières écossaises, loin de la sotte lecture (si même on le lit) qu’on fait de cet auteur. Non, il n’est pas le théoricien d’un ordre spontané de marché, conduit par une sorte de « main invisible » (une expression ultracélèbre mais qui veut dire pour Smith tout autre chose que le slogan qu’on répète aujourd’hui). Non, il n’est pas le chantre de l’intérêt individuel conduisant miraculeusement à l’intérêt collectif (la fable du boucher) : le concept de « sympathie » est pour lui tout aussi important que celui d’intérêt individuel. Non, il n’est pas le théoricien de la valeur-travail, une théorie reprise et développée par Ricardo et surtout Marx (avec les impasses auxquelles cela a conduit), mais dont, par préscience, il s’écarte prudemment.
Un très bon chapitre aussi sur Marx qui ronge assez sérieusement la cohérence de la pensée économique de Marx, mais d’où le lecteur sort un peu surpris : pourquoi alors, dans le reste de l’ouvrage, faut-il le glorifier à ce point en tant que visionnaire ? Pour Marx, la théorie de la valeur et de l’exploitation était le socle économique de sa compréhension sociale. Si cette théorie flanche, alors les dégâts à l’édifice sont beaucoup plus sérieux que l’entend Mistral. Le lecteur reste toujours fasciné par les analyses historiques de Marx, mais n’est pas convaincu qu’il arrive à intégrer pleinement la dynamique historique à son raisonnement économique ; il s’agit souvent plutôt d’un collage, d’une juxtaposition. C’est peut-être au fond sa théorie de la croissance (ou de la reproduction, dans ses termes) qu’il faut conserver parce qu’elle était novatrice.
Bien entendu, la théorie néoclassique y trouve bonne place, surtout Walras et la notion d’équilibre, de fonctionnement des marchés, qui ouvre le champ à la microéconomie et aux instruments qu’elle a permis de construire. Cette théorie rebute souvent parce qu’on la réduit à tort à une explication à partir de l’utilité égoïste de la personne. C’est faux, même si certains en usent quasiment de façon religieuse. Mistral dit bien qu’à en rester là, « l’économiste a peu de chances de nouer un dialogue fructueux [avec les autres sciences morales] si sa contribution à l’examen des conduites sociales se limite depuis les origines à cultiver un éloge sophistiqué de l’égoïsme et du profit » (p. 152)
La confrontation toujours renouvelée entre les « classiques » et les « néo-classiques » reste un élément qui vivifie la discipline : « On doit donc s’attendre à ce que la pensée économique s’interroge à la fois sur les lois de structure qui gouvernent […] la croissance, les crises, le chômage, les inégalités ; et sur les mécanismes présidant à la coordination d’une multitude de décisions décentralisées portant sur les produits, les coûts, la tarification des services publics, les choix d’investissement. » (p. 82) Même au travers de ses errements, la discipline économique a réussi à construire des outils d’analyse qui trouvent leurs applications dans la politique économique et fiscale, l’évaluation, la conduite des entreprises, pour citer quelques domaines.
Une petite critique, qui s’adresse surtout à Gallimard qui publie l’ouvrage et qui a sans doute pris au mot Mistral sur le terme d’« essai » qu’il emploie : il manque cruellement un index des noms propres utilisés et un récapitulatif bibliographique. Le lecteur est obligé de barbouiller de notes son livre pour s’y retrouver. Gageons que la prochaine édition y remédiera, ou les traductions en langue étrangère qui ne sauraient tarder. (Les éditeurs français, même les plus prestigieux, sont assez paresseux sur les ajouts bibliographiques.)
***
Venu à la fin de l’ouvrage, je me pose une petite question : pourquoi au fond faut-il s’intéresser à l’histoire des idées économiques ? Est-ce si important retrouver le Adam Smith d’origine ? Je livre ici ma petite réponse.Il y a différents niveaux de discours en matière de connaissance. Au niveau le plus assuré, cas des sciences de la nature, il y a accumulation directe de connaissances et le propre d’une science est alors de devenir anonyme. Rien ne sert de lire Lavoisier dans le texte d’origine pour connaître l’oxygène, ni Newton pour comprendre la chute des corps. Un manuel de 1er cycle universitaire le fait beaucoup mieux que les auteurs d’origine, à force d’avoir été enseigné des milliers de fois.
La philosophie est le niveau le moins assuré. Tout étudiant en philo lit et relit Platon, Spinoza et les autres. On se frotte au texte ou aux commentaires du texte pour poser en termes modernes la réflexion. L’accumulation de connaissances n’est pas comme un mur qu’on construit, mais un perpétuel va-et-vient. Le texte religieux va plus loin encore : sa richesse vient de son ambiguïté. Thomas d’Aquin disait « Si le Christ avait consigné par écrit sa doctrine, les hommes penseraient que son enseignement ne recèle rien de plus profond que la formule écrite », d’où, ajoute-t-il, que chez les païens aussi, Pythagore et Socrate, qui furent les plus remarquables des docteurs, n’ont rien voulu écrire.
Eh bien, l’économique est un peu entre les deux. On peut être un bon économiste sans avoir lu dans le texte Smith et Keynes. Mais en général les grands économistes d’aujourd’hui l’ont fait, même si les manuels modernes les résument assez bien. Il reste le besoin de se réclamer d’un grand auteur et de l’interpréter, y compris dans son ambiguïté. Un exemple : le génial chapitre 12 de la Théorie générale de Keynes où il parle de la formation des anticipations et de l’incertain en économie : des gens sérieux ont dépensé le gros de leur vie universitaire à gloser et ratiociner sur ce chapitre, preuve qu’il touche un vrai problème, mais probablement mal posé encore. Bref, il y a donc une partie « anonyme » de connaissances qui s’additionnent (on sait désormais ce qu’est l’effet d’une taxe, d’un tarif, etc.) et une partie qui est davantage circulaire, qui aide à organiser la pensée, à renouveler un débat, etc. Comme en philosophie, des questions reviennent de façon récurrente, avec les mêmes lignes de fracture entre économistes (exemple : le SMIC aide-t-il l’emploi ? L’État doit-il s’endetter ?) Certains désignent cette seconde partie par le terme d’idéologie, et pourquoi pas ? Car ce peut être de la bonne idéologie si les économistes conduisent le débat en s’accordant sur les règles de raisonnement. Il n’y a pas en économie des lois fixes qu’il conviendrait d’expliquer au mieux comme on le fait pour la chute des corps. La mise en contexte historique s’impose pour bien comprendre comment telle proposition a pu émerger, et dans quel contexte moderne elle émerge à nouveau. L’historien des idées n’a donc rien d’un antiquaire remuant la poussière. Dans cette réalité dont la complexité nous nargue et qui nous interdit de faire de l’expérimentation comme dans les sciences dures, on arrive à déceler certaines familles de problématiques et, par commodité, y rattacher un étendard, souvent le nom d’un grand penseur. Il y a alors un enjeu bien sûr scientifique, mais aussi idéologique, à ce que l’étendard soit le bon, qu’il n’y ait pas captation intellectuelle par quelqu’un qui voudrait attacher à ses propres convictions le « goodwill » du nom prestigieux (ainsi, nous dit Mistral, des néolibéraux qui ont opéré un rapt sur Adam Smith). Le monde il y a un quart de siècle était largement keynésien, croyant fortement à la régulation et à l’intervention de l’État après les chocs des grands conflits mondiaux. Puis, les économistes ont majoritairement basculé vers une approche « néolibérale », en partie sous l’effet de chocs technologiques qui ont semblé donner une prime aux pays choisissant la flexibilité la plus grande. Ayant sous les yeux certaines des conséquences de ce choix, on rebascule en ce moment vers une réappréciation du rôle de l’État et du bien commun. À voir. Mais, pendant ce temps, l’économique poursuit sa « demi »-accumulation de connaissances.
Cela ajoute plus qu’une demi-raison de lire Mistral.
« La science de la richesse. Essai sur la construction de la pensée économique » de Jacques Mistral, aux éditions Gallimard



















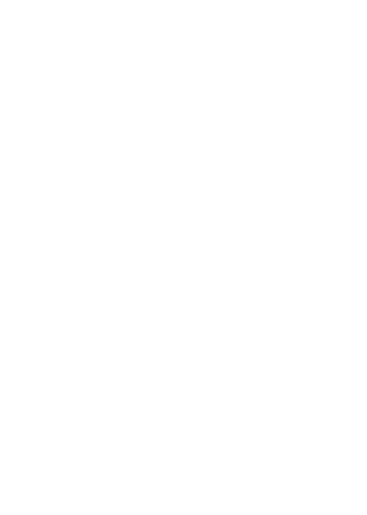
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.