
Au-delà du PIB ?
Le PIB est de façon récurrente l’objet de critiques car il concentre l’attention du public et des décideurs alors qu’il n’est pas un bon indicateur de bien-être social. Il ne mesure que l’ampleur des activités économiques, en omettant de nombreux déterminants du bien-être (y compris des déterminants économiques, par exemple des éléments de richesse) et en incluant des activités nuisibles ou réparatrices des dégâts de la croissance. La réponse des comptables nationaux à ces critiques, hormis le fait que la comptabilité nationale comprend bien d’autres données pertinentes (à commencer par le revenu national, qui tient compte des flux internationaux de revenus), est généralement que le PIB remplit bien son office mais qu’on lui demande trop. Les critiques qui lui sont faites concerneraient donc plus les mésusages des chiffres que le concept lui-même.
Le PIB remplit bien son office mais qu’on lui demande trop
Cette réponse n’entame pas le consensus qu’il serait très utile de disposer d’une mesure plus appropriée pour éclairer les décisions portant sur les grandes orientations économiques et sociales, et rendre plus pertinentes les comparaisons entre pays. La Commission pour la Mesure de la Performance Economique et du Progrès Social, présidée par J. Stiglitz et comprenant quatre prix Nobel, dont A. Sen comme conseiller spécial, a été mise en place pour faire des propositions en ce sens. Elle vient de rendre publique une note d’étape qui donne des indications sur les questions posées et les réponses envisagées.
Comme on pouvait s’y attendre d’après la diversité des approches dans les travaux antérieurs de ses membres, un nouvel indicateur unique a peu de chances de voir le jour dans cette Commission. Mais la Commission n’exclut pas de rechercher comment construire des indicateurs synthétiques, ce qui va au-delà d’une position assez répandue chez nos collègues de l’INSEE et selon laquelle des batteries de sous-indicateurs par domaine seraient préférables à un indicateur synthétique. Le débat sur cette question oppose souvent ceux qui vantent l’impact « politique » d’un indicateur synthétique à ceux qui veulent préserver la neutralité des statisticiens. Etant donné que les utilisateurs ont de toute façon soif d’indicateur phare (ce qui explique d’ailleurs l’attrait excessif du PIB), il me semble qu’il est important pour la statistique publique d’aller aussi loin que possible dans l’aide à la synthèse. Mais la diversité des conceptions animant les débats publics exigerait que l’on fournisse un indicateur synthétique pour chacune des principales conceptions en présence plutôt qu’un indicateur unique, lequel ne pourrait jamais être consensuel. Autrement dit, on peut sortir du dilemme « indicateur synthétique ou indicateurs partiels » en proposant plusieurs indicateurs synthétiques.
Dans cette perspective, il est très intéressant de voir percer dans les travaux de la Commission Stiglitz quatre approches qui sont le reflet de grandes orientations que l’on retrouve dans les débats politiques et dans les cercles philosophiques. A chacune de ces approches correspondent des besoins spécifiques en matière de statistiques et de collecte de données. En un mot, on se rattache à l’une ou l’autre de ces approches selon que l’on veut que les membres de la société (1) vivent bien, (2) soient heureux, (3) soient satisfaits, ou (4) obtiennent ce qu’ils souhaitent. En les voyant présentées de cette façon, on pourrait croire que ces approches sont difficiles à distinguer, et pourtant elles sont très différentes.
Vivre bien
La première approche est le perfectionnisme, qui considère possible et légitime de définir l’importance relative des composantes d’une vie satisfaisante de façon indépendante des préférences des individus concernés. Par exemple, la santé ou l’éducation peuvent apparaître comme des composantes essentielles, même si pour certains individus elles ont une importance secondaire dans leurs projets de vie. C’est ainsi que l’Indicateur de Développement Humain (IDH) calculé par le PNUD, combine par une moyenne arithmétique à pondérations égales (l’expression « non pondérée » serait trompeuse, car on n’échappe pas à la nécessité d’une pondération) trois sous-indicateurs mesurant la position relative des pays en matière de PIB, d’espérance de vie moyenne et d’éducation. La même pondération est appliquée à tous les pays, et la diversité des préférences individuelles n’y tient aucune place. Des pondérations plus ou moins justifiées apparaissent aussi dans les nombreux indicateurs sociaux synthétiques qui ont fleuri ces dernières années, tels que l’indicateur d’Osberg et Sharpe, ou celui des Miringoff. L’IDH est souvent présenté comme relié à l’approche des capabilités de Sen, bien qu’il en soit un pâle reflet car il agrège des moyennes nationales au lieu de faire la synthèse des différentes composantes (revenu, santé, éducation) au niveau individuel, ce qui est nécessaire si l’on veut évaluer les cumuls d’inégalités. Ce défaut affecte la plupart des indicateurs sociaux synthétiques et appellerait des progrès dans la collecte de données au niveau individuel. Cela exigerait une batterie d’enquêtes, avec des méthodes standardisées pour permettre les comparaisons internationales.
La principale faiblesse de cette approche réside dans le choix de la pondération, qu’il semble difficile de rationaliser. De nombreux auteurs dans cette mouvance envisagent de tempérer le perfectionnisme en adoptant des procédures participatives dans lesquelles des groupes (représentatifs ?) pourraient réfléchir aux pondérations. En contrepartie, cette approche procure l’avantage considérable d’échapper assez largement aux vicissitudes de la subjectivité humaine et de permettre d’utiliser des mesures objectives des situations individuelles.
Être heureux
La seconde approche est l’utilitarisme hédoniste, descendant directement de l’héritage de J. Bentham, et qui a connu ces dernières années un regain de vigueur tout à fait inattendu grâce aux études psychologiques et économiques sur le bonheur. En particulier, D. Kahneman et A. Krueger ont proposé deux indices synthétiques de bonheur ayant vocation à supplanter le PIB. Le premier consiste à évaluer le bilan net des affects ressentis au cours des activités quotidiennes, et à calculer la moyenne de ces bilans pondérée par le temps passé dans les différentes activités. On déduit ainsi de leurs enquêtes que le bonheur national pourrait être augmenté si les gens passaient plus de temps dans les relations intimes et les festivités et moins de temps au travail et dans les transports. Le second indice consiste à calculer la proportion du temps passé sous l’emprise d’affects négatifs (tristesse, énervement, stress, fatigue…). Il est moins sensible que le premier à l’évaluation cardinale des affects, et donc moins vulnérable aux erreurs de mesure ou aux hétérogénéités individuelles en matière d’interprétation ou d’utilisation des termes décrivant les affects.
Une faiblesse de cette approche est en effet l’incertitude qui entoure les comparaisons entre personnes. Plus problématique encore est le fait que la plupart des gens s’adaptent à leur vie, quelles qu’en soient les vicissitudes, de sorte qu’une société qui prendrait comme boussole le Bonheur National Brut (BNB) orienterait toute sa politique sociale vers la psychothérapie plutôt que vers la redistribution des richesses, et son budget de recherche serait englouti dans les laboratoires cherchant des euphorisants sans effet secondaire néfaste. Cela étant dit, on ne peut qu’être séduit par une approche qui sort du matérialisme étroit et de l’obsession de production et de richesse qui émanent de nos sociétés. S’il fallait choisir entre le PIB et le BNB, beaucoup opteraient pour le second.
Être satisfait
La troisième approche, le « welfarisme de la satisfaction », s’appuie sur la distinction très nette qui sépare, en psychologie, les affects des jugements cognitifs. On peut être plus ou moins satisfait de la vie qu’on mène, l’affectif n’en constitue qu’un aspect parmi d’autres plus objectifs. Par exemple, s’occuper des enfants n’est pas bien classé dans les enquêtes de bonheur car c’est une activité stressante et fatigante, mais n’est-ce pas l’une des tâches les plus nobles, qui donne les plus grandes satisfactions ? On pourrait en dire autant du travail, dont la valeur ne s’estime pas seulement, en termes de satisfaction sur la vie, par le flot de plaisir et de déplaisir qu’il procure. Malheureusement les enquêtes traditionnelles de satisfaction séparent assez mal les jugements cognitifs des affects, et une grande partie de la littérature économique sur le bonheur, à la recherche d’une notion floue « d’utilité », fait peu de cas de la différence. La récente enquête mondiale de Gallup attire l’attention car elle demande aux personnes de classer leur vie sur une échelle de 0 (« la pire des vies possibles ») à 10 (« la meilleure des vies possibles »), et l’on peut espérer qu’elle repère mieux les évaluations cognitives que les questions habituelles du genre « êtes-vous : -très-assez-peu-pas du tout satisfait de votre vie ces jours-ci ? ».
Cette approche souffre néanmoins de problèmes similaires à la précédente. Les comparaisons entre individus sont difficiles car la satisfaction se définit par rapport à une référence et les gens sont donc influencés par leur propre histoire personnelle et par leur groupe de référence. Se déclarer plus ou moins satisfait est aussi un phénomène culturel : les Américains, portés à l’emphase, sont nombreux à se dire « très satisfaits », alors que les Français sont très réticents à le dire mais sont finalement plus nombreux à être « très ou assez satisfaits ». C’est surtout la capacité des individus à adapter leur satisfaction à leurs circonstances qui peut mettre en doute l’intérêt de cette approche. Le paradoxe d’Easterlin, qui a fait couler beaucoup d’encre, met ainsi en relief le fait qu’à long terme la croissance économique a très peu d’impact sur le niveau de satisfaction. Est-ce si surprenant ? Il n’y a aucune raison pour qu’un individu ordinaire se déclare beaucoup plus satisfait de sa vie présente qu’un individu auquel on aurait posé la même question il y a 2000 ans. Cela veut dire, non pas que la croissance économique est inutile, mais bien plutôt que le niveau de satisfaction ne peut servir d’indicateur des progrès accomplis car l’étalon change avec les résultats obtenus. Cela étant dit, s’il fallait choisir entre le PIB, le BNB et la Satisfaction Nationale Brute, il y aurait des arguments pour préférer ce dernier indicateur, en particulier le fait qu’il paraît respectueux de donner plus d’importance à l’évaluation rationnelle qu’une personne fait de sa propre vie qu’à son vécu affectif.
Avoir ce que l'on souhaite
La quatrième approche peut être qualifiée de « libérale », au sens anglo-saxon du terme, car elle cherche à respecter les souhaits de chaque individu pour sa propre vie. La différence entre cette approche et la précédente tient au fait que la satisfaction d’un individu peut être atteinte de plusieurs façons : il peut obtenir ce qu’il souhaite, mais aussi ajuster ses aspirations à ses réalisations, ou encore adapter ses préférences à ses possibilités. L’approche libérale cherche à donner aux gens ce qu’ils souhaitent, pas à les voir « satisfaits » par n’importe quel moyen. Ainsi, pour le welfarisme de la satisfaction, la stabilité de la satisfaction dans le temps signifie qu’aucun progrès réel n’a été fait, tandis que pour l’approche libérale ce qui compte est que les gens préfèrent la situation finale à la situation initiale. Elle refuse de comparer des niveaux de satisfaction fondés sur des étalons différents.
Cette approche sous-tend la majeure partie de l’économie du bien-être, dans laquelle la « souveraineté du consommateur » a été un principe fondateur. Sa principale faiblesse réside dans la difficulté à faire des comparaisons entre les individus sans pouvoir comparer des niveaux de satisfaction. Plusieurs propositions s’affrontent, qui tournent autour de l’idée qu’il faut comparer les opportunités ou les ressources dont disposent les gens pour mener leur vie. Pour des raisons qu’il serait trop long d’exposer ici, il me semble qu’une certaine convergence apparaît entre d’anciennes propositions de Samuelson, des résultats de choix social suivant la méthodologie d’Arrow, et des développements de la théorie économique de l’équité, pour mettre en exergue la méthode de « l’équivalence ». Il s’agit d’une méthode de comparaison qui consiste à évaluer des courbes d’indifférence par leurs intersections respectives avec un chemin de référence. Une variante très intuitive de cette méthode, souvent évoquée dans la littérature économique mais finalement assez peu utilisée, consiste à calculer des « revenus équivalents ». Par exemple, un individu dont le revenu est de €2300 par mois pourrait accepter un revenu de €2000 si son espérance de vie était augmentée d’un an. Si l’on connaît les préférences des individus, on peut ainsi calculer des revenus équivalents en prenant une valeur de référence pour les dimensions non-monétaires de la qualité de vie (loisir, santé, sécurité, biens publics…). La figure 1 illustre ce concept.
G. Gaulier et moi avons tenté d’appliquer cette méthode à la comparaison des niveaux de vie entre pays de l’OCDE. On trouve ainsi que la France, avec une faible quantité de travail et une bonne espérance de vie, remonte dans les classements quand on passe du revenu ordinaire par tête au revenu équivalent par tête. Nos travaux ne sont qu’illustratifs, car nous manquons de données individuelles sur les préférences relatives aux différentes dimensions. Des enquêtes spécifiques, analogues à ce qui se fait couramment en analyse coût-bénéfice, seraient nécessaires pour avoir une bonne estimation non seulement du revenu équivalent moyen, mais également de sa distribution dans la population. Une autre difficulté avec cette approche réside dans la fixation des niveaux de référence pour les dimensions non-monétaires. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, cependant, ce choix n’est pas arbitraire car il est guidé par l’observation suivante : c’est quand un individu jouit des niveaux de référence que l’on peut évaluer sa situation par son revenu ordinaire, sans avoir besoin de connaître ses préférences.
La question centrale qui distingue les quatre approches décrites ici est le bon usage des données subjectives pour évaluer le bien-être de la population. Faut-il les ignorer ou presque (approche perfectionniste), chercher à mesurer une grandeur affective synthétique dénommée bonheur (approche hédoniste), une grandeur reflétant des jugements cognitifs comme le niveau de satisfaction (welfarisme de la satisfaction), ou s’intéresser seulement aux souhaits des gens au travers de leurs préférences ordinales (approche libérale) ? Je fais le pari que ces quatre approches seront avec nous pour très longtemps. Si c’est le cas, elles méritent chacune que les statisticiens essaient de les alimenter en données fiables.





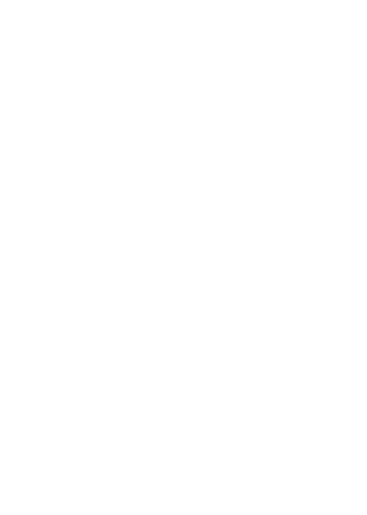
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.