
Liste des articles


Vue 2008 fois
08 février 2017
La petite histoire des 3 % du PIB
Publié par
Guy Abeille
| Politique économique
15 ans après la signature du traité de Maastricht, nous vous proposons de retrouver l'article initialement publié dans le numéro 40 de Variances dans lequel Guy Abeille revient sur la naissance du célèbre principe selon lequel le déficit public de chaque Etat ne peut excéder 3% du PIB.
Au frontispice du Pacte de Stabilité et de Croissance qui lie entre eux les Etats de la zone euro figure en lettres d’or le principe que, pour chaque Etat, le déficit public [2] rapporté au PIB (pour autant que déficit il dût y avoir) ne peut pas excéder la valeur de 3 %. Par le Pacte, et en ses termes mêmes, le 3 % du PIB est institué “valeur de référence”. Et c’est autour de lui, et de lui seul, qu’a été jusqu’ici bâtie toute la politique des éventuelles sanctions : son franchissement conduit à déclencher une solennelle “procédure pour déficit excessif ”, qui porte avec elle toute une gradation de peines.
Certains en attribuent la paternité à Jacques Attali (à moins que ce ne soit l’intéressé lui-même). D’autres au Premier Ministre Pierre Bérégovoy qui, si l’on en croit l’économiste Frédéric Lordon [3], lors des négociations de Maastricht “au dernier moment l’aurait sorti de sa poche”. Les plus savants rameutent à eux une certaine “formule de Domar”, dont la fabuleuse simplicité peut, on le conçoit, exercer un effet de sidération sur les esprits qui se parfument à l’économie. Le gri-gri mathématoïde qu’ils agitent est le suivant :
Tout autre, et bien plus prosaïque, est l’histoire que je raconte dans un article paru fin septembre 2010. J’y narre comment, fort de l’autorité non questionnée qui s’attache à l’expert, du pur circonstanciel progresse et prend substance au sein du tissu de l’appareil politico-technocratique, jusqu’à fabriquer de l’institutionnel.
C’est dans ces circonstances qu’un soir, tard, nous appelle Pierre Bilger (qui à quelque temps de là s’envolera vers Alcatel pour y faire la carrière que l’on sait), devenu le tout récent n°2 de la Direction du Budget. Nous : c’est-à-dire moi-même, et Roland de Villepin, camarade de promotion et récent chef de bureau. Formés à l’ENSAE, nous sommes considérés dans la faune locale comme appartenant à l’espèce, rare au Budget, des économistes (les autres sont des énarques, ces grands albatros de l’administration généraliste) ; et plus spécialement, car passablement mâtinés de mathématiques, de la sous-espèce des économistes manieurs de chiffres : sachant faire des additions, nous plaisante-t-on, en référence évidemment aux « agrégés-sachant-écrire ». Bilger nous informe en quelques mots du ballet budgétaire élyséen en cours, et il nous fait savoir que le Président a urgemment et personnellement demandé à disposer d’une règle simple, utilitaire mais marquée du chrême de l’expert, qu’il aura beau jeu de brandir à la face des plus coriaces de ses visiteurs budgétivores.
Il s’agit de faire vite. Villepin et moi nous n’avons guère d’idée, et à vrai dire nulle théorie économique n’est là pour nous apporter le soutien de ses constructions, ou pour même orienter notre réflexion. Mais commande est tombée du plus haut. Nous posons donc, d’un neurone perplexe, l’animal budgétaire sur la table de dissection.
Nous palpons du côté des dépenses, leur volume, leur structure, avec dette, sans dette, tel regroupement, tel autre, ou leur taux d’accroissement comparé à celui de l’économie. Il y aurait bien moyen de détailler à la main quelques ratios consommables, mais tout cela est lourd et fleure son labeur : norme flasque, sans impact, aucune n’est frappante comme une arme de jet, propre à marquer l’arrêt aux meutes dépensières. Nous retournons la bête du côté des recettes : impôts d’Etat sur revenu national ? Mais les impôts fluctuent avec la conjoncture, plusieurs sont décalés d’un an... Surtout, nous ne pouvons échapper à l’attraction des prélèvements obligatoires, dont la fiscalité d’Etat n’est guère qu’une part : peut-on valablement se cantonner à elle ? Le débat ne manquera pas de naître, à juste titre, et prendra vite le tour d’un brouhaha technique. Tout ça sera confus et sans force probante, au rebours du principe-étendard que nous avons reçu commande de faire surgir pour ostension publique. La route des recettes étant coupée, une seule voie nous reste : le déficit.
Le déficit, d’abord, du citoyen lambda au Président de format courant, c’est une notion qui parle à tout le monde : être en déficit, c’est être à court d’argent ou, si l’on préfère, tirer aujourd’hui un chèque sur demain, qui devra rembourser. Ensuite, le déficit a depuis Keynes acquis ses lettres de noblesse économique : il figure vaillamment dans les théories, il est une des plus visiblement opératoires variables des modèles. Lui seul, c’est évident, a la carrure et la netteté pour nous tirer d’affaire. Le déficit ! Mais qu’en faire ? A quelle contrainte le plier pour en extraire une norme ? Le coup est vite joué.
La bouée tous usages pour sauvetage du macroéconomiste en mal de référence, c’est le PIB : tout commence et tout s’achève avec le PIB, tout ce qui est un peu gros semble pouvoir lui être raisonnablement rapporté. Donc ce sera le ratio déficit sur PIB. Avec du déficit sur PIB, on croit tout de suite voir quelque chose de clair.
La deuxième observation touche à la pertinence du ratio lui-même : ne divise-t-on pas des choux par des carottes ? Car un déficit n’est rien d’autre qu’une dette : il est le chiffre exact de ce qu’il faut tout de suite emprunter, et donc de ce qu’il faudra épargner - au fil des années suivantes - pour rembourser ceux qui auront prêté. Autrement dit, afficher un pourcentage de déficit par rapport au PIB, c’est mettre en rapport le flux partitionné, échelonné des échéances à honorer dans les années futures avec la seule richesse produite en l’année origine. Il y a discordance des temps. Où l’on saisit que le seul critère pertinent est celui de la capacité de remboursement à horizon donné (qui est celui de l’emprunt). Capacité qui est elle-même fonction, non pas tant du déficit consenti une année donnée, que de la dette globale accumulée - cette année-là, mais aussi celles qui ont précédé et peut-être celles qui suivront - et de la prévision qu’en regard on peut faire des ressources futures, c’est-à-dire du couple croissance et rendement fiscal. Le reste n’est qu’affichage.
Dernière observation enfin, plus générale : on conçoit bien qu’un déficit n’a pas le même sens économique selon qu’il est purement ponctuel, rupture dans une série d’années à l’équilibre, laquelle sera réabsorbée en une à trois années par la réactivation même de l’économie que ce choc qu’à l’inverse il n’est que le morne jalon d’une longue chronique de déficits, courant les décennies, installés, métabolisés, devenus consubstantiels au fonctionnement même de l’économie. Où l’on aura compris que fixer le projecteur sur le déficit d’une année donnée n’a guère de sens, et que le rapporter au PIB de cette même année lui en fait perdre un peu plus. Le ratio déficit sur PIB peut au mieux offrir une indication : il situe une grandeur, il soupèse une ampleur, il fournit à bon compte une idée immédiate, intuitive de la dérive. Mais en aucun cas il n’a titre à servir de boussole ; il ne mesure rien ; il est jauge et non juge : il n’est pas un critère.
Le franc très vite plonge, il faut écoper le vaisseau. Mitterrand déleste le budget 1982, en cours de finition (on le présente en septembre), du déficit de 120 milliards où il se propulsait jusqu’à celui de 95 milliards qui sera annoncé, soit bien visiblement moins que le seuil symbolique – chiffon… rouge pour marchés en émoi -, des 100 milliards de francs (nos 3 % du PIB). Et c’est en août que Fabius, pour la première fois dans toute l’histoire de la langue publique universelle (car nul encore nulle part, serait-ce à l’étranger, n’a jamais avancé ce ratio), réfère le déficit au PIB.
Mais l’automne déjà, ses bourrasques ; et le franc balayé avec les premières feuilles : il faut dévaluer. Dans le combat des influences qui se joue cet automne, Delors reprend la main. Il ose parler de pause (un spectre hante la gauche, celui de Blum en février 1937 demandant “une pause nécessaire dans la montée des finances publiques...”). Et il est le premier à faire expressément savoir que le déficit ne doit plus franchir les 3 % du PIB, et cela pour l’ensemble des comptes publics (il sera bien le seul à être aussi strict, précis et complet). Fabius ne saurait lui abandonner cette paternité, qui est un empiètement et une dépossession. Et d’affirmer hautement, trois semaines plus tard : ”Pour le budget, j’ai toujours posé comme règle que le déficit n’était acceptable qu’à condition de ne pas dépasser un montant raisonnable, de l’ordre de 3 % du PIB”.
Dès lors dans les déclarations de Fabius, Delors, Mauroy…, le 3 % du PIB revient comme une antienne. Désormais bien en selle, il devient le marqueur proclamé, martelé, d’une “politique maîtrisée des finances publiques”.
Ce calcul, ce principe, il lui reste à recevoir encore, par les voies les plus solennelles, l’onction du Président. C’est chose faite le 9 juin 1982, après qu’on a durant tout le printemps, venus de l’Elysée, trouvé dans les journaux les mots “directive donnée de 3 % du PIB”, “consigne impérative de 3 % du PIB”. Lors de sa seconde conférence de presse du septennat, le Président dans son intervention liminaire déclare : “Le déficit est d’environ 3 % et il ne faut pas qu’il dépasse ce pourcentage appliqué au Produit intérieur brut. J’attends du gouvernement qu’il respecte ce plafond de 3 % et pas davantage.” Le processus d’acculturation est maintenant achevé.
Le 3 % du PIB se réjouit d’être critère. Et il a bien raison.
Une version plus courte de cet article a été précédemment publiée par le journal "La Tribune"
1 - Note de la rédaction
2 - Le déficit public est celui de l’ensemble constitué de l’administration centrale, des administrations régionales et locales, et des administrations de sécurité sociale.
3 - Voir son blog
4 - Tous ces quantums auraient été choisis en observant les valeurs moyennes qui prévalaient pour les économies européennes à l’instant des négociations de Maastricht
5 - The Burden of the Debt and the National Income.
La petite histoire des 3 % du PIB
L’attention de la rédaction de Variances a récemment été attirée par un article publié sur le site de La Tribune, dans lequel Guy Abeille décrit dans quelles circonstances le ratio de 3 % de déficit public rapporté au PIB aurait été « inventé » au début des années 1980, au sein de la Direction du Budget du Ministère des Finances. Nous avons demandé à cet ancien de l’Ecole de nous livrer une version simplifiée de son récit, à la fois évocation historique, réflexion sur la signification des statistiques et exercice de style [1].Au frontispice du Pacte de Stabilité et de Croissance qui lie entre eux les Etats de la zone euro figure en lettres d’or le principe que, pour chaque Etat, le déficit public [2] rapporté au PIB (pour autant que déficit il dût y avoir) ne peut pas excéder la valeur de 3 %. Par le Pacte, et en ses termes mêmes, le 3 % du PIB est institué “valeur de référence”. Et c’est autour de lui, et de lui seul, qu’a été jusqu’ici bâtie toute la politique des éventuelles sanctions : son franchissement conduit à déclencher une solennelle “procédure pour déficit excessif ”, qui porte avec elle toute une gradation de peines.
Aux sources de la norme
Ratio “déficit public sur PIB” et “valeur de référence” à 3 % : qu’est-ce qui a valu à cette norme son élection internationale ? Il court à ce propos diverses informations, bruits ou allégations.Certains en attribuent la paternité à Jacques Attali (à moins que ce ne soit l’intéressé lui-même). D’autres au Premier Ministre Pierre Bérégovoy qui, si l’on en croit l’économiste Frédéric Lordon [3], lors des négociations de Maastricht “au dernier moment l’aurait sorti de sa poche”. Les plus savants rameutent à eux une certaine “formule de Domar”, dont la fabuleuse simplicité peut, on le conçoit, exercer un effet de sidération sur les esprits qui se parfument à l’économie. Le gri-gri mathématoïde qu’ils agitent est le suivant :
d = g x D
triplette de fascinante beauté, dans laquelle d est le déficit public sur PIB, g le taux de croissance nominal de l’économie, et D la dette publique sur PIB. Et de le lire ainsi : Domar a établi qu’en vitesse de croisière, avec une croissance nominale de long terme égale à 5 %, on peut stabiliser la dette à 60 % du PIB en s’autorisant année après année un déficit qui n’excède pas 3 % du PIB [4]. Evsey Domar, mort en 1997, fut un économiste sérieux, professeur au MIT. En keynésien qu’il était, il a en effet publié au sortir de la guerre, en 1944, un ouvrage théorique sur les rapports entre croissance et endettement public [5], qui sert encore de base de réflexion à tous ceux qu’intéresse la question du caractère supportable à long terme de l’endettement public. Il va de soi que ni les raisonnements de Domar, ni ceux de ses commentateurs ou de ses critiques, autrement plus complexes, et qui font notamment et à juste titre entrer en ligne de compte le mode de financement de la dette, ne trouvent le moindre reflet dans cette formule caricaturale que d’aucuns lui attribuentTout autre, et bien plus prosaïque, est l’histoire que je raconte dans un article paru fin septembre 2010. J’y narre comment, fort de l’autorité non questionnée qui s’attache à l’expert, du pur circonstanciel progresse et prend substance au sein du tissu de l’appareil politico-technocratique, jusqu’à fabriquer de l’institutionnel.
De la fabrication du 3 % du PIB
La scène se passe un soir de juin 1981, à la Direction du Budget du Ministère des Finances où depuis trois ans, frais émoulu de l’Ecole, je suis chargé de suivre et d’analyser au mois le mois l’exécution du budget de l’Etat. Le bouleversement qu’est l’arrivée de la gauche au pouvoir vient tout juste d’avoir lieu, et s’il y a urgence pour adapter l’action budgétaire à la nouvelle donne, plus grande elle est encore pour préparer le budget de l’année 1982, qui sera la première de plein exercice pour la gauche au pouvoir. Las ! il nous revient assez vite que, dans l’effervescence de cette aube nouvelle et l’inaccoutumance des néo-ministres aux règles de gouvernement, ces derniers multiplient à qui mieux mieux les visites du soir auprès du Président pour plaider in vivo leurs besoins en crédits. Et, au vu des données qui s’agglomèrent peu à peu sur mon bureau, il apparaît assez vite qu’on se dirige bon train vers un déficit du budget initial pour 1982 qui franchira le seuil des 100 milliards de francs, chiffre que les plus intrépides d’entre nous n’auraient même en secret pas osé murmurer.C’est dans ces circonstances qu’un soir, tard, nous appelle Pierre Bilger (qui à quelque temps de là s’envolera vers Alcatel pour y faire la carrière que l’on sait), devenu le tout récent n°2 de la Direction du Budget. Nous : c’est-à-dire moi-même, et Roland de Villepin, camarade de promotion et récent chef de bureau. Formés à l’ENSAE, nous sommes considérés dans la faune locale comme appartenant à l’espèce, rare au Budget, des économistes (les autres sont des énarques, ces grands albatros de l’administration généraliste) ; et plus spécialement, car passablement mâtinés de mathématiques, de la sous-espèce des économistes manieurs de chiffres : sachant faire des additions, nous plaisante-t-on, en référence évidemment aux « agrégés-sachant-écrire ». Bilger nous informe en quelques mots du ballet budgétaire élyséen en cours, et il nous fait savoir que le Président a urgemment et personnellement demandé à disposer d’une règle simple, utilitaire mais marquée du chrême de l’expert, qu’il aura beau jeu de brandir à la face des plus coriaces de ses visiteurs budgétivores.
Il s’agit de faire vite. Villepin et moi nous n’avons guère d’idée, et à vrai dire nulle théorie économique n’est là pour nous apporter le soutien de ses constructions, ou pour même orienter notre réflexion. Mais commande est tombée du plus haut. Nous posons donc, d’un neurone perplexe, l’animal budgétaire sur la table de dissection.
Nous palpons du côté des dépenses, leur volume, leur structure, avec dette, sans dette, tel regroupement, tel autre, ou leur taux d’accroissement comparé à celui de l’économie. Il y aurait bien moyen de détailler à la main quelques ratios consommables, mais tout cela est lourd et fleure son labeur : norme flasque, sans impact, aucune n’est frappante comme une arme de jet, propre à marquer l’arrêt aux meutes dépensières. Nous retournons la bête du côté des recettes : impôts d’Etat sur revenu national ? Mais les impôts fluctuent avec la conjoncture, plusieurs sont décalés d’un an... Surtout, nous ne pouvons échapper à l’attraction des prélèvements obligatoires, dont la fiscalité d’Etat n’est guère qu’une part : peut-on valablement se cantonner à elle ? Le débat ne manquera pas de naître, à juste titre, et prendra vite le tour d’un brouhaha technique. Tout ça sera confus et sans force probante, au rebours du principe-étendard que nous avons reçu commande de faire surgir pour ostension publique. La route des recettes étant coupée, une seule voie nous reste : le déficit.
Le déficit, d’abord, du citoyen lambda au Président de format courant, c’est une notion qui parle à tout le monde : être en déficit, c’est être à court d’argent ou, si l’on préfère, tirer aujourd’hui un chèque sur demain, qui devra rembourser. Ensuite, le déficit a depuis Keynes acquis ses lettres de noblesse économique : il figure vaillamment dans les théories, il est une des plus visiblement opératoires variables des modèles. Lui seul, c’est évident, a la carrure et la netteté pour nous tirer d’affaire. Le déficit ! Mais qu’en faire ? A quelle contrainte le plier pour en extraire une norme ? Le coup est vite joué.
La bouée tous usages pour sauvetage du macroéconomiste en mal de référence, c’est le PIB : tout commence et tout s’achève avec le PIB, tout ce qui est un peu gros semble pouvoir lui être raisonnablement rapporté. Donc ce sera le ratio déficit sur PIB. Avec du déficit sur PIB, on croit tout de suite voir quelque chose de clair.
Un critère douteux
Arrivé à ce point, un peu de réflexion s’impose. On commencera par noter que le déficit est un solde, c’est-à-dire non pas une grandeur économique première, mais le résultat d’une opération entre deux grandeurs. Ce simple fait, trivial, emporte deux remarques. La première, c’est qu’un même déficit peut être obtenu par différence entre des masses dont l’ampleur est sans comparaison : 20 milliards sont aussi bien la différence entre 50 et 70 milliards qu’entre 150 et 170. Or, et c’est la deuxième remarque, on conviendra qu’il ne peut être tout à fait indifférent à la marche de l’économie que la masse des dépenses et recettes publiques soit d’une certaine ampleur (moins de 35 % du PIB, comme aux USA ou au Japon) plutôt que d’une autre, bien plus grande (nettement plus de 50 % comme en France ou dans les pays scandinaves). Sans même parler du contenu de chacune des masses : ce n’est pas la même chose d’aspirer un certain volume de recettes avec une TVA à 10 % et un impôt sur le revenu montant jusqu’à 80 %, qu’avec une TVA à 20 % et un impôt sur le revenu de 30 % au pire ; ou bien encore d’aligner un même volume de dépenses, mais avec 5 % de subventions d’investissement dans un cas ou 20 % dans l’autre. On voit donc que s’intéresser au déficit en soi, à son montant seul, n’a qu’un sens relatif.La deuxième observation touche à la pertinence du ratio lui-même : ne divise-t-on pas des choux par des carottes ? Car un déficit n’est rien d’autre qu’une dette : il est le chiffre exact de ce qu’il faut tout de suite emprunter, et donc de ce qu’il faudra épargner - au fil des années suivantes - pour rembourser ceux qui auront prêté. Autrement dit, afficher un pourcentage de déficit par rapport au PIB, c’est mettre en rapport le flux partitionné, échelonné des échéances à honorer dans les années futures avec la seule richesse produite en l’année origine. Il y a discordance des temps. Où l’on saisit que le seul critère pertinent est celui de la capacité de remboursement à horizon donné (qui est celui de l’emprunt). Capacité qui est elle-même fonction, non pas tant du déficit consenti une année donnée, que de la dette globale accumulée - cette année-là, mais aussi celles qui ont précédé et peut-être celles qui suivront - et de la prévision qu’en regard on peut faire des ressources futures, c’est-à-dire du couple croissance et rendement fiscal. Le reste n’est qu’affichage.
Dernière observation enfin, plus générale : on conçoit bien qu’un déficit n’a pas le même sens économique selon qu’il est purement ponctuel, rupture dans une série d’années à l’équilibre, laquelle sera réabsorbée en une à trois années par la réactivation même de l’économie que ce choc qu’à l’inverse il n’est que le morne jalon d’une longue chronique de déficits, courant les décennies, installés, métabolisés, devenus consubstantiels au fonctionnement même de l’économie. Où l’on aura compris que fixer le projecteur sur le déficit d’une année donnée n’a guère de sens, et que le rapporter au PIB de cette même année lui en fait perdre un peu plus. Le ratio déficit sur PIB peut au mieux offrir une indication : il situe une grandeur, il soupèse une ampleur, il fournit à bon compte une idée immédiate, intuitive de la dérive. Mais en aucun cas il n’a titre à servir de boussole ; il ne mesure rien ; il est jauge et non juge : il n’est pas un critère.
L’envol du 3 %
Pressés, en mal d’idée, mais conscients du garant de sérieux qu’apporte l’exhibition du PIB et de l’emprise que sur tout esprit un peu frotté d’économie exerce sa présence, nous fabriquons donc le ratio élémentaire « déficit sur PIB », objet bien rond, jolie chimère (au sens premier du mot). Reste à le flanquer d’un taux. C’est affaire d’une seconde. Nous regardons quelle est la plus récente prévision de PIB projetée par l’Insee pour 1982. Nous faisons entrer dans notre calculette le spectre des 100 milliards de déficit qui bouge sur notre bureau pour le budget en préparation. Le rapport des deux n’est pas loin de donner 3 %. On sait ce qu’il en est advenu.Le franc très vite plonge, il faut écoper le vaisseau. Mitterrand déleste le budget 1982, en cours de finition (on le présente en septembre), du déficit de 120 milliards où il se propulsait jusqu’à celui de 95 milliards qui sera annoncé, soit bien visiblement moins que le seuil symbolique – chiffon… rouge pour marchés en émoi -, des 100 milliards de francs (nos 3 % du PIB). Et c’est en août que Fabius, pour la première fois dans toute l’histoire de la langue publique universelle (car nul encore nulle part, serait-ce à l’étranger, n’a jamais avancé ce ratio), réfère le déficit au PIB.
Mais l’automne déjà, ses bourrasques ; et le franc balayé avec les premières feuilles : il faut dévaluer. Dans le combat des influences qui se joue cet automne, Delors reprend la main. Il ose parler de pause (un spectre hante la gauche, celui de Blum en février 1937 demandant “une pause nécessaire dans la montée des finances publiques...”). Et il est le premier à faire expressément savoir que le déficit ne doit plus franchir les 3 % du PIB, et cela pour l’ensemble des comptes publics (il sera bien le seul à être aussi strict, précis et complet). Fabius ne saurait lui abandonner cette paternité, qui est un empiètement et une dépossession. Et d’affirmer hautement, trois semaines plus tard : ”Pour le budget, j’ai toujours posé comme règle que le déficit n’était acceptable qu’à condition de ne pas dépasser un montant raisonnable, de l’ordre de 3 % du PIB”.
Dès lors dans les déclarations de Fabius, Delors, Mauroy…, le 3 % du PIB revient comme une antienne. Désormais bien en selle, il devient le marqueur proclamé, martelé, d’une “politique maîtrisée des finances publiques”.
Ce calcul, ce principe, il lui reste à recevoir encore, par les voies les plus solennelles, l’onction du Président. C’est chose faite le 9 juin 1982, après qu’on a durant tout le printemps, venus de l’Elysée, trouvé dans les journaux les mots “directive donnée de 3 % du PIB”, “consigne impérative de 3 % du PIB”. Lors de sa seconde conférence de presse du septennat, le Président dans son intervention liminaire déclare : “Le déficit est d’environ 3 % et il ne faut pas qu’il dépasse ce pourcentage appliqué au Produit intérieur brut. J’attends du gouvernement qu’il respecte ce plafond de 3 % et pas davantage.” Le processus d’acculturation est maintenant achevé.
Extension du domaine du ratio
Puis un jour le traité de Maastricht parut sur le métier. Ce 3 %, on l’avait sous la main, c’est une commodité ; en France on en usait, pensez ! chiffre d’expert ! Il passe donc à l’Europe ; et de là, pour un peu, il s’étendrait au monde. Sans aucun contenu, et fruit des circonstances, d’un calcul à la demande monté faute de mieux un soir dans un bureau, le voilà paradigme : sur lui on ne s’interroge plus, il tombe sous le sens (à vrai dire très en dessous), c’est un critère vrai. Construction contingente du discours, autorité de la parole savante, l’évidence comme leurre ou le bocal de verre (celui dans lequel on s’agite, et parade, sans en voir les parois) : Michel Foucault aurait adoré. Parfois lorsque j’entends, repris comme un mantra, le 3 % du PIB, je m’amuse de ce trois que nous avons choisi. Me revient le souvenir du numero deus impare gaudet - le nombre impair plaît à la divinité - qu’on trouve dans Virgile. Et la traduction qu’en donne Gide dans Paludes : le nombre deux se réjouit d’être impair. Et il a bien raison, ajoute Gide.Le 3 % du PIB se réjouit d’être critère. Et il a bien raison.
Une version plus courte de cet article a été précédemment publiée par le journal "La Tribune"
1 - Note de la rédaction
2 - Le déficit public est celui de l’ensemble constitué de l’administration centrale, des administrations régionales et locales, et des administrations de sécurité sociale.
3 - Voir son blog
4 - Tous ces quantums auraient été choisis en observant les valeurs moyennes qui prévalaient pour les économies européennes à l’instant des négociations de Maastricht
5 - The Burden of the Debt and the National Income.





















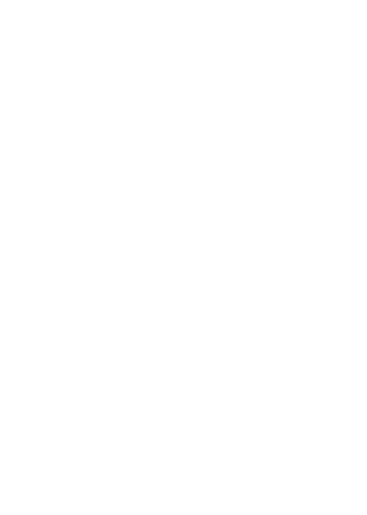
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.