
Liste des articles



Vue 49 fois
14 décembre 2018
Portrait de Raphaël Sobotka (1997), de Chopin à la gestion de portefeuilles
Publié par
Eric Tazé-Bernard
| Nos alumni
Evoluant dans le même métier, et tous deux alumni de l’ENSAE, nous nous étions croisés quelquefois au cours des années et échangions agréablement. Puis je l’ai vu arriver dans mon entreprise il y a quatre ans et il est alors devenu mon responsable. Pas facile a priori de se retrouver avec un patron ayant vingt ans de moins que soi , mais j’ai rapidement apprécié sa puissance intellectuelle, sa grande curiosité, et il s’est toujours montré respectueux et bienveillant à mon égard. Il a changé depuis de périmètre d’activité, je ne lui suis plus rattaché et me sens donc plus libre aujourd’hui de dresser son portrait pour les lecteurs et les lectrices de variances.eu.
Variances.eu : Raphaël, peux-tu nous rappeler brièvement ton parcours et nous dire d’abord comment tu t’es retrouvé à l’ENSAE ?
Raphaël Sobotka: contrairement à beaucoup, je ne suis pas rentré à l’ENSAE par hasard. Issu d’une famille de scientifiques - médecins, mathématiciens -, je me suis pris de passion pour l’économie dès le lycée, où je m’étais orienté vers la section Economie. Un oncle m’avait offert un ouvrage de Jean-Marie Albertini, qui m’a intéressé, j’en ai acheté d’autres. Puis, bon élève, j’ai suivi la filière Sup-Spé après le bac, et c’est assez naturellement que j’ai choisi l’ENSAE pour sa spécialisation à la fois en mathématiques et en économie. Une fois dans l’Ecole, je me suis particulièrement intéressé aux probabilités, aux statistiques et à la macroéconomie. J’ai suivi en parallèle les cours du Delta[1]. Mon souhait était alors en effet de m’orienter vers la recherche en économie, mais j’ai suivi également de cours de finance à l’Ecole et, ne me voyant pas passer des années dans un laboratoire de recherche, j’ai finalement décidé de poursuivre dans cette voie de la finance.
V : Et te voilà lancé dans une carrière dans la gestion d’actifs !
R.S. Là, c’est plutôt le fruit du hasard. Mon premier contact avec le secteur financier a pris la forme de stages dans des activités de trading sur des salles de marché, certes intéressants, mais où j’ai trouvé les relations humaines très agressives. A ma sortie de l’Ecole, j’ai donc répondu à une annonce en asset management, chez ce qui s’appelait alors CCF Capital Management, et je suis resté depuis dans ce secteur. Je trouve qu’il me convient bien : il requiert des compétences macroéconomiques et de mathématiques financières, son « espace temps » me convient, car l’horizon d’investissement y est long, en tout cas bien plus long que dans une salle de marché, et le rôle de l’asset management dans la société est plus défendable, puisqu’il s’agit d’aider les investisseurs à gérer leur épargne, notamment en vue de la retraite.
J’ajoute que dans ce métier, sans doute comme dans beaucoup d’autres, ce que l’on ne sait pas domine ce que l’on sait. Il s’agit alors de probabiliser des gains ou des pertes en univers incertain, et pour cela il est nécessaire de maîtriser ses biais cognitifs. Quels sont les domaines dans lesquels on considère en savoir davantage que la moyenne des intervenants? Quelles sont les circonstances de marché que nous estimons pouvoir mieux exploiter que les autres ?
V : Je comprends ta passion pour ce métier, mais peux-tu nous en dire plus sur ta fonction actuelle ?
R.S. J’ai commencé ma carrière dans une équipe d’ingénierie financière, dont je suis devenu le responsable, avant d’évoluer vers un poste de gérant, puis de responsable d’une équipe de gestion, en Multigestion (sélection de fonds et gestion de fonds de fonds). Après une quinzaine d’années dans le groupe CCF puis HSBC, j’ai rejoint Amundi, leader européen de la gestion d’actifs, il y a un peu plus de quatre ans, et j’y suis responsable d’une équipe de gestion « Multi Asset » (ou gestion diversifiée).
Lorsque l’on dirige une équipe de gestion, le sujet important est celui du processus d’investissement, c’est-à-dire la machine qui cherche à créer de l’« alpha », ou de la valeur ajoutée dans la gestion, en s’appuyant sur les membres de l’équipe. Il n’existe pas une « recette » unique, le processus ne peut en effet être indépendant des personnes qui constituent l’équipe, il doit s’adapter à leur expérience des marchés, à leurs biais cognitifs. Il existe des tensions naturelles dans une équipe, des différences par exemple en termes d’aversion au risque, de courage pour prendre des positions ou les tenir dans le temps. Certain.e.s sont d’excellent.e.s spécialistes d’un domaine mais sont plus à l’aise face à un problème fermé qu’ils ou elles vont tenter de creuser à fond, d’autres sont davantage des généralistes dont la force tient à leur capacité à problématiser un contexte complexe dans un cadre cohérent simplifié. La clé du succès tient à une bonne compréhension de ces biais individuels, pour pouvoir les assembler de manière optimale.
Mais le processus doit également être adapté au produit que l’on gère : la manière de générer de la performance dépend en effet également des attentes des clients. Après une forte correction de marchés, il peut par exemple sembler particulièrement justifié sur la base d’une analyse purement financière de fortement augmenter ses positions en actifs risqués, mais on s’abstiendra de le faire si l’on sait que les clients ne suivront pas. Dans ce cas, même si les marchés nous donnent finalement raison, si les investisseurs sont entre-temps sortis du fonds que l’on gère pour eux, on a échoué.
V : Les éléments que tu évoques illustrent ton intérêt pour la finance comportementale. Comment l’intégrer dans un processus d’investissement ? Et quel regard portes-tu sur l’essor du big data, quel pourrait en être l’impact sur le métier de gérant de portefeuilles ?
R.S. Sur le big data, mon analyse est que si l’on aborde le problème comme tous les autres intervenants, on est à peu près sûr de ne pas apporter beaucoup de valeur. Analyser des séries de prix d’actifs financiers, les mélanger avec des indicateurs macroéconomiques, voilà ce que font des tas de participants de marché depuis bien longtemps. Il faut donc chercher dans d’autres directions pour tenter de se différencier. Par exemple analyser le « newsflow » ?, j’entends par là non pas les grandes informations financières que tous les opérateurs regardent, mais plutôt les signaux faibles. On peut aussi investir dans le développement d’algorithmes pour améliorer le trading, travailler plus finement l’exécution des décisions d’investissement : gagner quelques points de base lorsque les rendements des actifs financiers sont aussi faibles qu’aujourd’hui n’est pas négligeable.
Je crois aussi à l’intérêt d’algorithmes permettant d’analyser les comportements des gérants, de détecter les comportements atypiques, par exemple lorsque dans un contexte de marché exceptionnel le flux d’ordres se tarit, ou lorsque des gérants réputés pour leur biais baissier se mettent à acheter… Pourquoi pas également utiliser des techniques nouvelles, par exemple géo-spatiales pour détecter des changements de comportements des agents économiques plus tôt que les autres analystes? Par exemple, l’observation d’un moindre remplissage des parkings d’hypermarchés peut aider à anticiper plus rapidement un ralentissement de la consommation.
V : Je te vois régulièrement t’exercer à l’heure du déjeuner, avec une virtuosité certaine, sur le piano situé près du restaurant d’entreprise. Difficile donc d’ignorer ta passion pour cet instrument. Quelle en est l’origine ?
R.S. La musique fait vraiment partie de ma famille: ma mère chante, mon père écoute beaucoup de musique. J’ai commencé le solfège à l’âge de 4 ans, le piano à 6 ans, puis je me suis mis à l’orgue, à l’harmonie, j’ai touché un peu à tout, y compris à la musique pop, mais c’est à la musique classique que je me consacre exclusivement aujourd’hui. C’est clairement un élément important de ma vie, je n’ai jamais cessé de travailler - en ce moment sur la fantaisie en do de Schumann et la balade en sol de Chopin -. La musique aide à s’échapper, à remettre à plat ses émotions, à évacuer la pression de la performance, qui sinon risque de vous faire faire des bêtises. Mais je joue pour moi, je ne me produis pas en concert, ça ne me réussit pas : on ne joue pas de la même façon en public que pour soi, car l’on n’entend pas seulement ce qui sort du piano mais aussi ce qu’on a dans la tête…
V : Vois-tu un lien entre gestion d’actifs et musique ?
R.S. Premier point commun, la musique est un exercice intellectuel. La maîtrise technique est nécessaire pour parfaire sa capacité d’écoute et parvenir à faire chanter ensemble les différentes voix qui s’enchevêtrent dans un morceau. Plus l’on progresse techniquement, plus le niveau de musicalité de ce que l’on joue augmente.
Mais la musique, c’est aussi de la créativité. Jeune, j’aimais composer, je ne le fais plus guère, mais le fait déjà de faire « sonner » les voix qui constituent un morceau, c’est de la créativité. Jouer du piano, c’est aussi être créatif par rapport à un quotidien de management et d’application de process, qui consiste le plus souvent à « faire tourner la boutique ».
V : Revenons à ta carrière professionnelle, comment te projettes-tu sur les prochaines années ?
R.S. Mon souhait est de continuer dans le métier de la gestion d’actifs, et si possible avec des responsabilités plus larges d’équipes de gestion, car je pense que je suis bon pour prendre, en exerçant mon jugement, des décisions de bon sens sur des sujets très compliqués entachés de fortes incertitudes.
J’ajoute que j’ai toujours eu un goût prononcé pour les données, je n’ai jamais eu peur de mettre moi-même les mains dans la programmation, y compris chez moi - ma famille me l’a parfois reproché : « Ah!, papa fait encore de l’ordinateur ! ». Il est clair que je vais continuer à m’intéresser à l’essor des data, et que je pourrais envisager de m’impliquer davantage dans des process organisés autour de ces données, sans d’ailleurs qu’il s’agisse nécessairement de process systématiques, car la dimension comportementale me semble devoir toujours être prise en compte.
V : On constate un très fort intérêt des jeunes ENSAE pour les métiers des données, alors que l’on ne jurait que par la finance il y a vingt ans. Estimes-tu cette tendance durable ?
R.S. Si j’avais 20 ans aujourd’hui, je m’orienterais sans doute vers les métiers des données. La mode est à la technologique, à l’intelligence artificielle, et l’on a l‘impression en travaillant dans ces domaines de participer aux bouleversements du monde. Mais comme dans toute innovation, il y aura un moment où la poussière retombera et dans cette perspective je recommanderais de s’investir dans un domaine dans lequel utiliser ces données. Les métiers de la finance sont sans doute plutôt en retard en la matière, et il est encore difficile de mesurer dans quelle mesure ils seront impactés par ces nouvelles techniques. Mais je suis sûr que pour être compétitif demain dans le domaine financier, il faudra maîtriser ces sujets de data !
V : Quels conseils plus généraux aimerais-tu prodiguer à de jeunes diplômé.es qui s’interrogent sur leur future carrière ?
R.S. Je trouve qu’un important facteur de bonheur consiste à identifier aussi tôt que possible ce que l’on sait bien faire et ce qui ne nous convient pas. On devient bon plus facilement dans ce que l’on aime faire, on le travaille alors davantage, et on devient encore meilleur, ce qui nourrit le plaisir de ce que l’on fait.
Autre conseil important : bien choisir avec qui on travaille. Le bonheur vient aussi de ceux avec qui l’on parcourt une aventure professionnelle. Cela s’applique aux individus mais aussi aux entreprises, dont la culture nous convient plus ou moins. Je suis naturellement attiré par les environnements qui me permettent d’être en phase avec mes valeurs, l’ouverture et la transparence au premier chef. Je ne sais pas cultiver l’ambiguïté, contrairement à d’autres qui parviennent mieux à dissimuler leurs valeurs profondes pour gérer leur carrière. C’est important d’être au clair sur ses valeurs.
Il faut aussi savoir être résilient, face à un changement qui s’accélère dans notre société et dans le monde professionnel, face aussi aux injonctions paradoxales que l’on reçoit en permanence dans les entreprises. A chacun de trouver les moyens de cultiver sa résilience. Dans mon cas, c’est en m’appuyant sur ma famille, le piano et le sport.
[1] Le DELTA, réunion du Centre d’Économie Quantitative et Comparative de l’EHESS et du Laboratoire d’Économie Politique de l’ENS, a été créé en 1998. Progressivement, différents laboratoires rejoindront le DELTA sur le campus Jourdan : le Laboratoire d’économie appliquée de l’INRA (1998), puis le Laboratoire des Sciences Sociales de l’ENS (1998), le CEPREMAP (2001 - créé en 1967) et le CERAS (2002).
Variances.eu : Raphaël, peux-tu nous rappeler brièvement ton parcours et nous dire d’abord comment tu t’es retrouvé à l’ENSAE ?
Raphaël Sobotka: contrairement à beaucoup, je ne suis pas rentré à l’ENSAE par hasard. Issu d’une famille de scientifiques - médecins, mathématiciens -, je me suis pris de passion pour l’économie dès le lycée, où je m’étais orienté vers la section Economie. Un oncle m’avait offert un ouvrage de Jean-Marie Albertini, qui m’a intéressé, j’en ai acheté d’autres. Puis, bon élève, j’ai suivi la filière Sup-Spé après le bac, et c’est assez naturellement que j’ai choisi l’ENSAE pour sa spécialisation à la fois en mathématiques et en économie. Une fois dans l’Ecole, je me suis particulièrement intéressé aux probabilités, aux statistiques et à la macroéconomie. J’ai suivi en parallèle les cours du Delta[1]. Mon souhait était alors en effet de m’orienter vers la recherche en économie, mais j’ai suivi également de cours de finance à l’Ecole et, ne me voyant pas passer des années dans un laboratoire de recherche, j’ai finalement décidé de poursuivre dans cette voie de la finance.
V : Et te voilà lancé dans une carrière dans la gestion d’actifs !
R.S. Là, c’est plutôt le fruit du hasard. Mon premier contact avec le secteur financier a pris la forme de stages dans des activités de trading sur des salles de marché, certes intéressants, mais où j’ai trouvé les relations humaines très agressives. A ma sortie de l’Ecole, j’ai donc répondu à une annonce en asset management, chez ce qui s’appelait alors CCF Capital Management, et je suis resté depuis dans ce secteur. Je trouve qu’il me convient bien : il requiert des compétences macroéconomiques et de mathématiques financières, son « espace temps » me convient, car l’horizon d’investissement y est long, en tout cas bien plus long que dans une salle de marché, et le rôle de l’asset management dans la société est plus défendable, puisqu’il s’agit d’aider les investisseurs à gérer leur épargne, notamment en vue de la retraite.
J’ajoute que dans ce métier, sans doute comme dans beaucoup d’autres, ce que l’on ne sait pas domine ce que l’on sait. Il s’agit alors de probabiliser des gains ou des pertes en univers incertain, et pour cela il est nécessaire de maîtriser ses biais cognitifs. Quels sont les domaines dans lesquels on considère en savoir davantage que la moyenne des intervenants? Quelles sont les circonstances de marché que nous estimons pouvoir mieux exploiter que les autres ?
V : Je comprends ta passion pour ce métier, mais peux-tu nous en dire plus sur ta fonction actuelle ?
R.S. J’ai commencé ma carrière dans une équipe d’ingénierie financière, dont je suis devenu le responsable, avant d’évoluer vers un poste de gérant, puis de responsable d’une équipe de gestion, en Multigestion (sélection de fonds et gestion de fonds de fonds). Après une quinzaine d’années dans le groupe CCF puis HSBC, j’ai rejoint Amundi, leader européen de la gestion d’actifs, il y a un peu plus de quatre ans, et j’y suis responsable d’une équipe de gestion « Multi Asset » (ou gestion diversifiée).
Lorsque l’on dirige une équipe de gestion, le sujet important est celui du processus d’investissement, c’est-à-dire la machine qui cherche à créer de l’« alpha », ou de la valeur ajoutée dans la gestion, en s’appuyant sur les membres de l’équipe. Il n’existe pas une « recette » unique, le processus ne peut en effet être indépendant des personnes qui constituent l’équipe, il doit s’adapter à leur expérience des marchés, à leurs biais cognitifs. Il existe des tensions naturelles dans une équipe, des différences par exemple en termes d’aversion au risque, de courage pour prendre des positions ou les tenir dans le temps. Certain.e.s sont d’excellent.e.s spécialistes d’un domaine mais sont plus à l’aise face à un problème fermé qu’ils ou elles vont tenter de creuser à fond, d’autres sont davantage des généralistes dont la force tient à leur capacité à problématiser un contexte complexe dans un cadre cohérent simplifié. La clé du succès tient à une bonne compréhension de ces biais individuels, pour pouvoir les assembler de manière optimale.
Mais le processus doit également être adapté au produit que l’on gère : la manière de générer de la performance dépend en effet également des attentes des clients. Après une forte correction de marchés, il peut par exemple sembler particulièrement justifié sur la base d’une analyse purement financière de fortement augmenter ses positions en actifs risqués, mais on s’abstiendra de le faire si l’on sait que les clients ne suivront pas. Dans ce cas, même si les marchés nous donnent finalement raison, si les investisseurs sont entre-temps sortis du fonds que l’on gère pour eux, on a échoué.
V : Les éléments que tu évoques illustrent ton intérêt pour la finance comportementale. Comment l’intégrer dans un processus d’investissement ? Et quel regard portes-tu sur l’essor du big data, quel pourrait en être l’impact sur le métier de gérant de portefeuilles ?
R.S. Sur le big data, mon analyse est que si l’on aborde le problème comme tous les autres intervenants, on est à peu près sûr de ne pas apporter beaucoup de valeur. Analyser des séries de prix d’actifs financiers, les mélanger avec des indicateurs macroéconomiques, voilà ce que font des tas de participants de marché depuis bien longtemps. Il faut donc chercher dans d’autres directions pour tenter de se différencier. Par exemple analyser le « newsflow » ?, j’entends par là non pas les grandes informations financières que tous les opérateurs regardent, mais plutôt les signaux faibles. On peut aussi investir dans le développement d’algorithmes pour améliorer le trading, travailler plus finement l’exécution des décisions d’investissement : gagner quelques points de base lorsque les rendements des actifs financiers sont aussi faibles qu’aujourd’hui n’est pas négligeable.
Je crois aussi à l’intérêt d’algorithmes permettant d’analyser les comportements des gérants, de détecter les comportements atypiques, par exemple lorsque dans un contexte de marché exceptionnel le flux d’ordres se tarit, ou lorsque des gérants réputés pour leur biais baissier se mettent à acheter… Pourquoi pas également utiliser des techniques nouvelles, par exemple géo-spatiales pour détecter des changements de comportements des agents économiques plus tôt que les autres analystes? Par exemple, l’observation d’un moindre remplissage des parkings d’hypermarchés peut aider à anticiper plus rapidement un ralentissement de la consommation.
V : Je te vois régulièrement t’exercer à l’heure du déjeuner, avec une virtuosité certaine, sur le piano situé près du restaurant d’entreprise. Difficile donc d’ignorer ta passion pour cet instrument. Quelle en est l’origine ?
R.S. La musique fait vraiment partie de ma famille: ma mère chante, mon père écoute beaucoup de musique. J’ai commencé le solfège à l’âge de 4 ans, le piano à 6 ans, puis je me suis mis à l’orgue, à l’harmonie, j’ai touché un peu à tout, y compris à la musique pop, mais c’est à la musique classique que je me consacre exclusivement aujourd’hui. C’est clairement un élément important de ma vie, je n’ai jamais cessé de travailler - en ce moment sur la fantaisie en do de Schumann et la balade en sol de Chopin -. La musique aide à s’échapper, à remettre à plat ses émotions, à évacuer la pression de la performance, qui sinon risque de vous faire faire des bêtises. Mais je joue pour moi, je ne me produis pas en concert, ça ne me réussit pas : on ne joue pas de la même façon en public que pour soi, car l’on n’entend pas seulement ce qui sort du piano mais aussi ce qu’on a dans la tête…
V : Vois-tu un lien entre gestion d’actifs et musique ?
R.S. Premier point commun, la musique est un exercice intellectuel. La maîtrise technique est nécessaire pour parfaire sa capacité d’écoute et parvenir à faire chanter ensemble les différentes voix qui s’enchevêtrent dans un morceau. Plus l’on progresse techniquement, plus le niveau de musicalité de ce que l’on joue augmente.
Mais la musique, c’est aussi de la créativité. Jeune, j’aimais composer, je ne le fais plus guère, mais le fait déjà de faire « sonner » les voix qui constituent un morceau, c’est de la créativité. Jouer du piano, c’est aussi être créatif par rapport à un quotidien de management et d’application de process, qui consiste le plus souvent à « faire tourner la boutique ».
V : Revenons à ta carrière professionnelle, comment te projettes-tu sur les prochaines années ?
R.S. Mon souhait est de continuer dans le métier de la gestion d’actifs, et si possible avec des responsabilités plus larges d’équipes de gestion, car je pense que je suis bon pour prendre, en exerçant mon jugement, des décisions de bon sens sur des sujets très compliqués entachés de fortes incertitudes.
J’ajoute que j’ai toujours eu un goût prononcé pour les données, je n’ai jamais eu peur de mettre moi-même les mains dans la programmation, y compris chez moi - ma famille me l’a parfois reproché : « Ah!, papa fait encore de l’ordinateur ! ». Il est clair que je vais continuer à m’intéresser à l’essor des data, et que je pourrais envisager de m’impliquer davantage dans des process organisés autour de ces données, sans d’ailleurs qu’il s’agisse nécessairement de process systématiques, car la dimension comportementale me semble devoir toujours être prise en compte.
V : On constate un très fort intérêt des jeunes ENSAE pour les métiers des données, alors que l’on ne jurait que par la finance il y a vingt ans. Estimes-tu cette tendance durable ?
R.S. Si j’avais 20 ans aujourd’hui, je m’orienterais sans doute vers les métiers des données. La mode est à la technologique, à l’intelligence artificielle, et l’on a l‘impression en travaillant dans ces domaines de participer aux bouleversements du monde. Mais comme dans toute innovation, il y aura un moment où la poussière retombera et dans cette perspective je recommanderais de s’investir dans un domaine dans lequel utiliser ces données. Les métiers de la finance sont sans doute plutôt en retard en la matière, et il est encore difficile de mesurer dans quelle mesure ils seront impactés par ces nouvelles techniques. Mais je suis sûr que pour être compétitif demain dans le domaine financier, il faudra maîtriser ces sujets de data !
V : Quels conseils plus généraux aimerais-tu prodiguer à de jeunes diplômé.es qui s’interrogent sur leur future carrière ?
R.S. Je trouve qu’un important facteur de bonheur consiste à identifier aussi tôt que possible ce que l’on sait bien faire et ce qui ne nous convient pas. On devient bon plus facilement dans ce que l’on aime faire, on le travaille alors davantage, et on devient encore meilleur, ce qui nourrit le plaisir de ce que l’on fait.
Autre conseil important : bien choisir avec qui on travaille. Le bonheur vient aussi de ceux avec qui l’on parcourt une aventure professionnelle. Cela s’applique aux individus mais aussi aux entreprises, dont la culture nous convient plus ou moins. Je suis naturellement attiré par les environnements qui me permettent d’être en phase avec mes valeurs, l’ouverture et la transparence au premier chef. Je ne sais pas cultiver l’ambiguïté, contrairement à d’autres qui parviennent mieux à dissimuler leurs valeurs profondes pour gérer leur carrière. C’est important d’être au clair sur ses valeurs.
Il faut aussi savoir être résilient, face à un changement qui s’accélère dans notre société et dans le monde professionnel, face aussi aux injonctions paradoxales que l’on reçoit en permanence dans les entreprises. A chacun de trouver les moyens de cultiver sa résilience. Dans mon cas, c’est en m’appuyant sur ma famille, le piano et le sport.
[1] Le DELTA, réunion du Centre d’Économie Quantitative et Comparative de l’EHESS et du Laboratoire d’Économie Politique de l’ENS, a été créé en 1998. Progressivement, différents laboratoires rejoindront le DELTA sur le campus Jourdan : le Laboratoire d’économie appliquée de l’INRA (1998), puis le Laboratoire des Sciences Sociales de l’ENS (1998), le CEPREMAP (2001 - créé en 1967) et le CERAS (2002).
Auteur

Eric Tazé-Bernard est président de la société ETBAllocation et fondateur de la Fondation Perrin-Tazé pour l'insertion des jeunes en difficulté et l'humanisation des parcours de soin.
Il a été Chief Allocation Adviser au sein de l'équipe OCIO Solutions d'Amundi de 2013 à 2022, après avoir rejoint Amundi en 2008 en tant que responsable de la Multigestion "long-only". Il était précédemment Directeur Général de la Gestion Financière de la société INVESCO Asset Management (2001-2008), après avoir été Responsable de la Multigestion de BNP Paribas Asset Management de 1999 à 2001, et Responsable Stratégie et Allocation d'actifs de Credit Agricole Asset Management de 1993 à 1998. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1983 à la SEDES (Groupe Caisse des Dépôts) avant de rejoindre la Banque Indosuez en 1987 comme économiste. ENSAE 1978, il est également
titulaire d'un Master en Economie de l'Université de Californie à Berkeley, d'un DEA d'Economie Publique et d'une Licence en Droit. Il a enseigné la gestion d'actifs à HEC et à l'Université Paris Dauphine, et a été membre du Comité Financier de la Fondation de France de 2010 à 2020. Il a publié en 2010 avec Pierre Hervé: "La Multigestion; une méthode de gestion d'actifs" chez Economica et a été pendant 14 ans le responsable de la publication Variances puis variances.eu. Voir les 25 Voir les autres publications de l’auteur(trice)
Il a été Chief Allocation Adviser au sein de l'équipe OCIO Solutions d'Amundi de 2013 à 2022, après avoir rejoint Amundi en 2008 en tant que responsable de la Multigestion "long-only". Il était précédemment Directeur Général de la Gestion Financière de la société INVESCO Asset Management (2001-2008), après avoir été Responsable de la Multigestion de BNP Paribas Asset Management de 1999 à 2001, et Responsable Stratégie et Allocation d'actifs de Credit Agricole Asset Management de 1993 à 1998. Il a commencé sa carrière professionnelle en 1983 à la SEDES (Groupe Caisse des Dépôts) avant de rejoindre la Banque Indosuez en 1987 comme économiste. ENSAE 1978, il est également
titulaire d'un Master en Economie de l'Université de Californie à Berkeley, d'un DEA d'Economie Publique et d'une Licence en Droit. Il a enseigné la gestion d'actifs à HEC et à l'Université Paris Dauphine, et a été membre du Comité Financier de la Fondation de France de 2010 à 2020. Il a publié en 2010 avec Pierre Hervé: "La Multigestion; une méthode de gestion d'actifs" chez Economica et a été pendant 14 ans le responsable de la publication Variances puis variances.eu. Voir les 25 Voir les autres publications de l’auteur(trice)























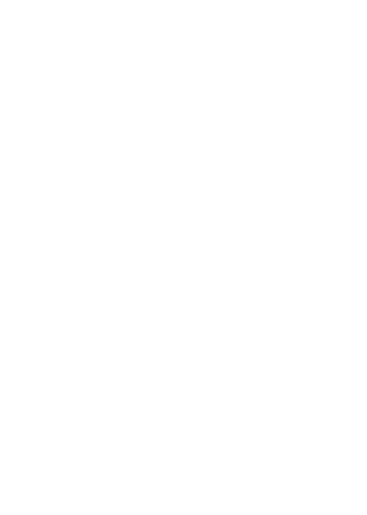
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.