
Stephane Marchand, ENSAE 1986 Rédacteur en chef Adjoint du Figaro Economie
Un ENSAE à la tête d’un service d’économie internationale, peu étonnant ? Si l’on ajoute que ce service est celui d’un grand quotidien national et qu’avant de s’asseoir au cahier saumon Stéphane Marchand a arpenté le monde comme reporter politique, le parcours devient particulièrement original.
“ Je ne suis pas du tout arrivé au journalisme par l’économie mais par le grand reportage : reportage de guerre, politique étrangère. A l’X, j’avais fait mon service dans le VIeme régiment de parachutistes d’infanterie de marine. J’avais été dans une ambiance où on voyageait beaucoup et plutôt dans des pays bizarres et en guerre. C’est là qu’est née véritablement ma vocation. Je suis rentré au Figaro en sortant de l’Ensae, donc en 1986. J’ai été reporter pendant deux ans, durant lesquels je suis allé au Sri Lanka, en Finlande, au Cameroun, en Ethiopie, au Soudan… sans logique générale… Ensuite, je suis parti comme correspondant au Proche Orient pendant deux ans. A Jérusalem, j’ai couvert l’Intifada et la guerre au Liban. Puis je suis parti comme correspondant politique du journal à Washington où je suis resté sept ans.
Ce poste à Washington a été une opportunité. Je m’étais marié, j’avais eu des enfants et j’estimais que ce n’était plus compatible avec une activité dans des pays finalement assez risqués. Je suis revenu à Paris en 1997 et depuis je suis ici. J’ai couvert les problèmes du terrorisme et de la Corse avant de passer à l’économie. Je suis maintenant rédacteur en chef adjoint du cahier saumon du Figaro. C’est mon titre, ma fonction c’est chef du service d’économie internationale.
Un parcours dans le vaste monde
Je ne suis pas un scientifique forcené. C’est pour cela qu’en sortant de l’X je suis allé à l’Ensae : j’en avais assez des sciences pures. Mon choix était donc beaucoup plus guidé par l’économie que par les statistiques et même, n’étant pas un mordu des modèles, par la partie la moins scientifique de l’économie. Après mon lycée à Franklin j’avais fait une Math Sup à Stan’, mais sans avoir d’idée préconçue de ce que je voulais faire. Choisir HEC aurait été plus logique compte tenu de ce que je suis devenu. En l’occurrence la logique n’a pas prévalu, mais je crois que les études, que ce soit, l’Ensae, l’X ou la prépa, cela ne sert pas tant par ce que l’on y apprend que par les efforts que l’on y fait. On y acquiert plutôt une méthode de travail : j’ai appris que l’on peut faire un effort gigantesque pendant un laps de temps assez long. Evidemment, la rigueur que l’on y professe compte aussi énormément. Non pas que j’étais des plus rigoureux mais quand même, j’étais au contact de la rigueur. Et cela compte même lorsque l’on quitte la sphère des sciences. J’écris des romans. Ce sont des livres que j’espère plaisants, amusants et vivants. Mais au service de ce plaisant, amusant, vivant, je mets le maximum de rigueur et c’est clair que je l’ai apprise là. Dans mon cas, c’est un soin particulier dans la construction de l’ouvrage, la vérification des faits ou une application à ne jamais laisser quelque chose de flou. Autre exemple : mon travail de journaliste, c’est d’écrire le français. Ca paraît idiot, mais c’est un exercice qui pour être bien fait demande beaucoup de rigueur. Cette rigueur, je ne l’ai pas apprise dans une khâgne où à Sciences Po, je l’ai apprise à l’X et à l’Ensae. Je l’ai appliquée aux Maths, aux statistiques, je l’injecte maintenant dans l’écriture. De mes années de journalisme, je retiens que la fibre principale chez moi, c’est le vaste monde. La France est un pays qui a plein de qualités, mais c’est un vieux pays, qui est enfoncé dans toute une série de réflexes qui sont toujours les mêmes. Comparé à des pays comme Israël, les Etats- Unis ou même l’Espagne qui sont des pays qui bougent plus, qui sont plus souples, c’est un pays assez immobile. Aujourd’hui, je ne supporte plus les ambiances franco-françaises. Mais cet attrait de l’autre, du monde, a été assez tardif. Jusqu’à l’âge de vingt ans, je n’étais pas très tourné vers l’étranger. J’ai fait un voyage en Inde qui m’a laissé un grand souvenir. Ca a été un choc évident par rapport aux pays que j’avais connu auparavant, l’Angleterre et la Suisse, mais je crois que c’est vraiment les sept années aux Etats- Unis qui ont tout changé. La liberté, l’espace, la taille, l’impression que tout est possible, ce sont les clichés habituels, mais ils sont vrais ! Notamment, je suis journaliste, la puissance extraordinaire de la presse. Et puis la vie politique là-bas est très marrante… L’Amérique, c’est génial ! Sept ans passés aux Etats-Unis rendent complètement inadapté au francofrançais. A l’époque, j’avais d’ailleurs écrit un livre, French Blues, où je revenais sur cela. Paris, par exemple, est une ville magnifique, agréable, mais assoupie. Il n’y a pas de happening urbain comme dans les villes américaines ou même dans certaines villes de Province. C’est une ville achevée. Ceci dit la société américaine vit sur des valeurs profondément différentes des nôtres. Et si j’espère que mes enfants iront aux Etats-Unis, je ne sais pas si je souhaite qu’ils s’y installent…
Ecrire sur les coulisses
Au quotidien, je suis maintenant responsable de la couverture par le journal des problèmes économiques internationaux : mon rôle est de choisir des sujets, les titres, les chapeaux. C’est moi qui envoie les reporters à l’étranger sur des sujets précis ou pour la couverture des grandes réunions internationales, comme les réunions du G8 ou les rencontres importantes de l’OMC, etc. J’écris parfois des éditoriaux, mais en me concentrant toujours sur les aspects d’économie internationale. Nous sommes une quarantaine de personnes à travailler
L’équation d’exigence
Pendant ces quinze années, changer de travail m’a parfois traversé l’esprit ; mais le journalisme c’est un choix que j’ai fait et je ne vais pas le remettre en cause aujourd’hui. Ma vie est organisée entre le Figaro et mes livres. Je suis en ce moment en train de terminer un documentaire télévisé qu’on a adapté du livre que j’ai écrit l’année dernière. Je suis sur un autre livre, … Ma vie repose largement sur le journalisme. Et finalement, ne pas avoir fait d’école de journalisme ne m’a pas desservi. Ce qui m’a aidé, au moment de l’embauche, c’est d’avoir deux diplômes de bonne tenue. Ceci dit, je suis très favorable aux écoles de journalisme parce que c’est bien que les gens qui font le même métier partagent un certain nombre de choses même si ensuite ils prennent chacun leurs libertés. C’est pareil pour les économistes et l’Ensae. Que l’école soit spécialisée dans un certain type d’enseignement n’est pas gênant. Il y a d’autres écoles d’économie et sur le marché on sait que l’Ensae produit des gens de ce type là. C’est bien qu’ils aient des références communes.
Aujourd’hui, étant donné mon poste, il m’arrive souvent de rencontrer des Ensae. Chaque fois que je suis en contact avec des gens de Bercy, par exemple. Mais je dois avouer que j’ai gardé assez peu de contacts avec les anciens. Ce n’est pas à ce moment de ma vie que j’ai tissé des relations très étroites. Par contre, l’école ne m’a jamais oublié. Par exemple, même aux Etats-Unis, je recevais le journal des offres d’emplois… En conclusion, je dirais que le secret des bonnes écoles, c’est l’exigence que cela représente. Quand on a fait ces écoles, on a vu ce qu’était l’exigence. Même si on ne l’a pas pratiqué, même si on a été à l’époque réfractaire, et c’est là la beauté de la chose, l’exigence comme valeur est inscrite au fer rouge dans la conscience. On sait ensuite très vite reconnaître un travail médiocre et bâclé quel que soit le domaine ou presque. Tu sais reconnaître une pièce de théâtre ou un scénario qui a été bâclé ! Tout le secret c’est ça : fabriquer des gens exigeants. »
Propos recueillis par Frédéric GILLI
(ENSAE 2000)




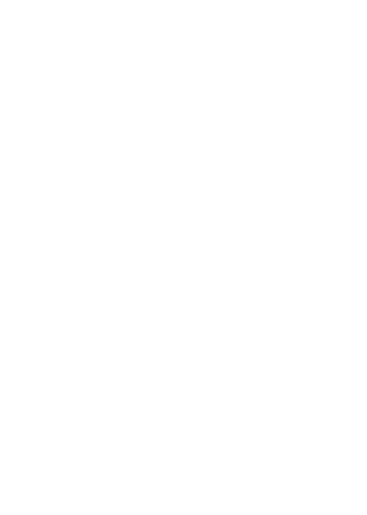
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.