
Les premiers pas de l’informatique à l’INSEE (1ère partie)
Daniel Hoffsaes (1956), ancien administrateur de l’Insee, a commencé sa carrière comme responsable du premier matériel de calcul électronique acquis par l’Insee. Il nous raconte cette aventure.
Aujourd’hui, l’informatique est omniprésente. Peut-on imaginer ce que serait le fonctionnement d’une entreprise ou d’un service public comme l’Insee, sans ces ordinateurs, grands et petits, devenus pour tous l’outil de travail essentiel ? Et pourtant, il y a seulement cinquante ans, ils n’existaient pas !
Depuis, l’informatique a évolué d’une manière étonnante. Je viens de taper ce texte sur un iMac de la taille d’un écran de télévision, posé sur un bureau et relié au monde entier via Internet. La première « calculatrice électronique » de l’Insee, elle, occupait une salle immense qui accueillait ses armoires de plusieurs mètres de long, refroidies par une usine de climatisation installée dans le sous-sol ! Et, pour seul lien avec le monde extérieur, des supports de papier, ou cartes perforées, et des bandes magnétiques. De l’un à l’autre, la fréquence de base est devenue 9 000 fois plus rapide, la mémoire de travail 30 000 fois plus grande et la mémoire permanente 900 000 fois plus spacieuse.
Tournez, tournez manivelles !
Débarrassé du service militaire, j’entrais en 1954 à l’école d’application qui préparait en deux années aux métiers de l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’école se situait alors quai Branly, à l’emplacement du futur musée des Arts Premiers. L’informatique y était à sa préhistoire.
La plupart des cours se tenaient dans ces locaux, à l’exception du cours d’économie, professé à l’École des Mines par un futur prix Nobel, Maurice Allais, champion de l’économie mathématique. L’Institut Blaise Pascal abritait des cours de probabilité et de statistiques. Autant le reconnaître, les cours d’économie me passionnaient peu, malgré les personnalités fascinantes qui les professaient. Outre Maurice Allais, un certain Raymond Barre, pas encore homme politique, ni « meilleur économiste de France ».
Les travaux pratiques étaient de rigueur, pour apprendre à calculer des moyennes, des variances et autres fonctions statistiques, pour additionner des colonnes de nombres, les élever au carré, faire des cumuls, avec le seul outil disponible à l’époque, la calculatrice manuelle. Pour calculer, il fallait actionner la manivelle de ces machines à roues dentées, pas très éloignées de celle de Blaise Pascal. Tout était alors dans le coup de poignée.
Pour une multiplication, faire tourner l’ensemble des roues représentant le multiplicande, autant de fois que la valeur de chaque chiffre du multiplicateur, avec un décalage du multiplicande à chaque pas. Pour la division, les faire tourner de façon analogue mais en sens inverse. Autant dire que le calcul ne pouvait porter sur de grandes séries de nombres. Le calcul matriciel n’était pas à l’ordre du jour, ni à Polytechnique, ni à l’Ensae.
Les perforatrices du mécanographe
Pour traiter les masses d’informations issues des enquêtes menées auprès de la population, des entreprises ou des exploitations agricoles, l’Insee utilisait alors des machines à cartes perforées, inventées aux Etats-Unis par Hollerith pour le Census Américain. La science de la mécanographie était enseignée à l’Ecole. C’était un administrateur, nommé Lions, qui en avait la charge. Il était responsable de l’atelier central de l’Institut, situé rue Boulitte, dans le 14ème arrondissement. Il venait de l’industrie et son métier en faisait presque un patron de PME, à la tête d’un grand ensemble de mécanographie avec son atelier de perforation de cartes et sa salle de machines pour l’exploitation des dites cartes.
Ces cartes ? Des petits cartons rectangulaires de 18,7 cm sur 8,3 cm, comportant 80 colonnes en longueur et 12 lignes en hauteur. Chaque colonne pouvait recevoir un chiffre, identifié par une perforation dans l’une des dix lignes « 0 » à « 9 », ou une lettre, obtenue par combinaison d’une perforation dans l’une des dix lignes de chiffre et d’une perforation dans l’une des deux autres lignes. Le dessin de la carte, propre à chaque application, décrivait la manière dont les quatre-vingts caractères étaient ventilés en zones d’informations.
Dans l’atelier, des femmes, assises toute la journée devant leur machine, les perforaient. Elles lisaient les codifications portées sur les questionnaires traités et tapaient d’un même mouvement sur les claviers de perforation sans regarder leurs doigts. Grâce à l’électricité, elles tapaient moins forts qu’auparavant, lorsque le tapé du doigt devait être assez fort pour déclencher le poinçon de perforation.
Les cartes perforées passaient ensuite sur un poste de vérification où le même travail recommençait, la machine comparant alors chaque caractère frappé avec celui de la carte.
Des primes de performance en sus du salaire de base récompensaient les meilleures cadences de saisie, au-delà des 8 000 frappes moyennes à l’heure en perforation et 10 000 frappes en vérification.
Les cartes passaient ensuite à l’atelier d’exploitation, avec ses machines spécialisées : les trieuses, les interclasseuses, les tabulatrices et les reproductrices.
Les trieuses classaient les cartes selon les valeurs d’une zone choisie comme critère de tri. Au cours de chaque lecture, la machine analysait une des colonnes de la carte et envoyait celle-ci dans la case de réception correspondant au chiffre lu.
Pour une zone à plusieurs chiffres, le tri commençait par les unités. L’opérateur réglait le balai de lecture sur la colonne de tri des unités. Il alimentait la machine en y plaçant les cartes du fichier à trier. Il ramassait à la sortie les cartes dans les cases de réception, en commençant par la case « 0 » et en terminant par la « 9 », lorsque le tri était dans l’ordre croissant, pour obtenir un nouveau paquet de cartes. Le balai de lecture était décalé d’une position vers la gauche, pour le chiffre des dizaines, et le manège recommençait, remontant pas à pas, sur la gauche vers les chiffres de plus fort poids. Au dernier passage, le fichier était classé dans l’ordre voulu, à la vitesse de 400 cartes par minute.
L’interclasseuse comportait deux pistes de lecture et deux cases de réception. À la cadence de 200 à 300 cartes par minute, elle comparait deux fichiers classés dans le même ordre en analysant la zone commune de tri située sur chaque jeu de cartes pour en sortir, soit un fichier interclassé selon cette zone, soit deux fichiers dont l’un était expurgé des cartes correspondantes situées dans l’autre.
Au bout de la chaîne, la tabulatrice, la plus « savante » de toutes, régnait. Elle lisait les 80 colonnes des cartes et pouvait en imprimer le contenu, totaliser certaines zones dans des compteurs, extraire les cumuls lors d’une rupture dans le critère de classement, puis cumuler le contenu de ces compteurs dans d’autres totalisateurs de niveau supérieur. Par exemple, pour un fichier de données classées par département et à l’intérieur par commune, la tabulatrice permettait d’imprimer un total par commune, en premier niveau de rupture, puis de cumuler les chiffres de cette commune dans les totalisateurs du département. Jusqu’à trois niveaux de contrôle étaient possibles sur ces machines.
Le Bull de la rue Boulitte
Toutes les tabulatrices étaient « programmées » (on n’utilisait pas ce terme à l’époque) à l’aide d’un tableau de connexion. Ce tableau, une fois ôté de la machine, faisait apparaître des écheveaux de fils enfichés dans des plots. Les connexions acheminaient les impulsions électriques détectées par les quatre-vingt balais de lecture vers des circuits pour déclencher l’impression ou le cumul dans des compteurs. Le « préparateur » en était le grand machiniste. Muni de son cahier des charges, avec le dessin des cartes et des modèles d’état demandé, il effectuait tous les branchements sur le tableau de connexion puis plaçait le tableau sur la machine puis testait son travail sur un jeu d’essai. Ensuite, il n’y avait plus qu’à alimenter les cartes dans le lecteur de la machine et à surveiller le défilement de la liasse de papier.
Lors d’un stage à la rue Boulitte, j’eus l’occasion de préparer le travail de l’une de ces machines. L’atelier était équipé en matériel Bull. D’autres ateliers en province avaient des IBM, l’Insee partageant son parc entre les deux grands constructeurs du moment. Les Bull et les IBM fonctionnaient suivant des principes semblables, seules les réalisations pratiques variant. Par exemple, l’impression chez Bull se faisait à l’aide de cent roues portant chacune l’ensemble des caractères alphanumériques. Chez IBM, c’était avec des barres de caractères, ce qui nuisait un peu à leur rapidité d’impression.
Les facultés de calcul de ces machines étaient assez limitées. Elles se bornaient à des tabulations en excluant pratiquement tout calcul horizontal sur le contenu d’une carte. Une multiplication ou une division entre deux zones de la carte était impossible. Pour accroître ses capacités, il fallait connecter la tabulatrice avec d’autres machines : une reproductrice par exemple, pour perforer des cartes avec le résultat des tabulations, ou des calculatrices, qui pouvait effectuer les quatre opérations sur les zones d’une carte et renvoyer à la tabulatrice les résultats de ses calculs, pour impression, cumul ou perforation sur la reproductrice. Les calculatrices étaient cependant peu utilisées pour le dépouillement des enquêtes statistiques, car mal connues des utilisateurs éventuels. Elles allaient constituer le « chaînon » reliant l’ère de la mécanographie à celle des ensembles électroniques. En se renforçant et en « s’électronisant », elles allaient donner naissance aux ordinateurs. Après les machines spécialisées, la machine universelle.
Quand l’agriculture pousse le numérographe
En 1955-1956, l’Insee procéda au recensement général de l’agriculture, pilier d’une France encore largement rurale à l’époque. Avec dix types de questionnaires d’environ cent cinquante questions chacun et 2 500 000 exploitations à recenser réparties entre 38 000 communes, le projet était très ambitieux. Pour chaque exploitation agricole, neuf cartes perforées de 80 colonnes, en moyenne. Le matériel mécanographique classique, déjà saturé par les travaux habituels, était hors d’état d’affronter la complexité technique de ce dépouillement. Il eut fallu acquérir, pour le traiter, une bonne douzaine de tabulatrices avec leurs matériels annexes et y ajouter un calculateur électronique pour faire face aux besoins de calcul exigés par ce type d’enquête.
L’Insee reçut alors une proposition d’Eliott, un constructeur Britannique, qui proposait un matériel d’un nouveau type : un calculateur électronique à tambour magnétique. Ce tambour magnétique offrait une mémoire à grande capacité. Plus besoin de trier les cartes pour chaque exploitation, les tableaux pouvaient être obtenus par ventilation en mémoire et plusieurs tableaux pouvaient être calculés au cours d’un seul passage des données de base. C’était une révolution. La décision fut prise de la mener.
Un appel d’offre fut donc lancé pour obtenir un matériel qui devait permettre de traiter en quinze mois la confection et l’impression, à partir de onze millions de cartes, de plus de 300 000 tableaux. Il fut envoyé à quatre fournisseurs éventuels qui avaient en catalogue des projets de calculatrices à tambour, ou « ensembles électroniques de la première génération » comme on les appela plus tard.. Tous ces matériels comprenaient déjà les principaux composants des futurs ordinateurs, mais ils se différenciaient par leurs moyens d’entrée-sortie et c’est sur ce critère que se fit le choix final.
Eliott concourut bien sûr, en proposant une entrée et une sortie de données sur bande magnétique. Une autre société, française cette fois, la Société d’Électronique et d’Automatisme (SEA), fit de même. A côté de ces outsiders, Bull et IBM, les deux leaders du marché, ne proposaient que des tabulatrices à l’entrée et à la sortie, utilisées pour lire les cartes et imprimer les tableaux : la Compagnie des machines Bull venait de sortir son « ordonnateur » Gamma tambour, extension de son calculateur électronique Gamma 3 ; IBM présentait son premier modèle de 650, qu’il dénommait déjà ordinateur, à cause d’une faute de frappe d’une secrétaire d’IBM ayant mal lu le mot « ordonnateur » plaisantaient les techniciens de Bull.
La SEA l’emporta grâce à un instrument original qu’elle avait imaginé comme moyen d’affichage des résultats : le « numérographe ». Son principe consistait à afficher sur un écran cathodique les états à imprimer, puis à filmer à l’aide d’une caméra la succession de ces affichages. La machine devait ainsi livrer un microfilm qui permettait d’obtenir dans de bonnes conditions les résultats du recensement, sous un volume réduit et à grande vitesse (2 000 caractères à la seconde). La « « Calculatrice Arithmétique Binaire 3026 », ou « CAB 3026 », avait été conçue par le patron de la SEA, le professeur F.H. Raymond, assisté de l’ingénieur Namian et d’une équipe de techniciens spécialisés dans les matériels de calcul analogique mais prêts à se lancer dans une nouvelle voie : les machines digitales.
Sur les conseils des techniciens de la SEA, l’Insee rechercha alors un administrateur pour s’occuper de la CAB. À cette époque, jeune administrateur de l’Insee, je sortais tout juste de l’école. J’aurais pu obtenir un poste dans une direction régionale mais cette perspective de carrière ne m’enthousiasmait guère et je fus désigné, sans d’ailleurs beaucoup de concurrence, responsable du premier ensemble électronique de l’Insee. C’était pour moi un saut dans l’inconnu. Je n’avais aucune formation sur le sujet, comme tout le monde à l’époque. Dès ma prise de fonction, je partis donc faire un stage à la SEA.
« 0 », « 1 », l’arrivée des digits
La SEA, située à Courbevoie, était surtout spécialisée dans les matériels d’automatisme. Elle fabriquait, entre autres, des calculatrices analogiques. Ces machines étaient destinées à résoudre certaines équations mathématiques à l’aide de circuits électriques dont les propriétés physiques correspondaient aux relations que l’on voulait tester. En faisant varier l’un des paramètres d’entrée (une résistance électrique par exemple), on analysait le résultat en mesurant un des phénomènes physiques (une tension ou une intensité) qui représentait le résultat que l’on voulait connaître. Inutile de dire que les possibilités de ces machines étaient très limitées et réservées à des applications purement industrielles.
La SEA venait de se lancer dans l’aventure des machines digitales qui, elles, allaient avoir un grand essor. Au lieu de travailler sur des variables continues, ces machines opèrent sur des « digits », c’est-à-dire des nombres binaires représentant de manière codée les valeurs discontinues sur lesquelles on veut opérer. Pour cela, ces matériels comportent des mémoires pour stocker ces codes et des opérateurs arithmétiques et logiques permettant de les traiter. La SEA avait adopté pour son projet de « calculatrice électronique » le schéma défini par von Neuman avec mémoires, bloc de calcul, circuits de commande et organes externes.
Une première famille de matériels, les calculatrices 2000, existait déjà. L’une d’entre elles se trouvait dans les locaux de la SEA et une autre était en service au ministère de l’armement. La logique de cette machine correspondait déjà à celle de notre CAB 3026 alors en cours de construction. C’est sur ces CAB 2000 que je fis mes premières armes en programmation. La SEA avait repris, pour ce premier type de machine, le système inventé par Eliott et elle avait adopté son langage de programmation.
La machine était très pauvre en mémoires, l’essentiel étant constitué par un tambour magnétique qui pouvait stocker 8 000 ou 16 000 « mots », chaque mot étant constitué de 22 digits codés 0 ou 1. Chaque emplacement de mémoire pouvait donc recevoir un nombre binaire de 22 chiffres, ou une instruction de programme. Cette possibilité de stocker des instructions représentait un progrès essentiel dans le mode de fonctionnement de ces machines. Sur toutes les calculatrices ou matériels de traitement antérieurs, la commande se faisait par un organe extérieur, par exemple le câblage d’un tableau sur la tabulatrice. Désormais, les commandes étaient enregistrées dans la machine de la même manière et dans les mêmes mémoires que les données à traiter. C’est ce progrès essentiel, le programme enregistré, qui a fait de ces calculatrices des machines universelles et des ordinateurs.
Le schéma général de ces machines était et est encore le suivant :
La mémoire reçoit au départ, via l’organe d’entrée (en l’occurrence ici un ruban perforé) le programme à exécuter, sous forme d’instructions codées dont chacune correspond à une opération élémentaire (addition, soustraction, opération logique, accès à la mémoire ou à une entrée-sortie, etc).
Les circuits de commande accèdent ensuite à ces instructions, qu’ils identifient puis exécutent l’une après l’autre. Par exemple, pour une opération arithmétique, un nombre est extrait d’une case de mémoire, envoyé vers le bloc calculateur, qui effectue l’opération demandée, puis le résultat est rangé dans une autre case de mémoire.
Le programme s’exécute dans l’ordre où sont rangées les instructions, sauf lorsque l’une d’entre elles provoque une rupture liée au résultat d’une opération logique : par exemple pour déclencher deux types de traitement différents selon qu’un nombre est positif ou négatif.
Les cases de mémoire contiennent indifféremment données et instructions de programme, rien, à leur contenu, ne permettant de savoir si c’est un nombre ou une instruction mais le programmeur, lui, le sait !
Des tores de ferrites organisés en matrice
La taille de la mémoire et la rapidité de traitement et d’accès à la mémoire sont deux caractéristiques importantes pour jauger la capacité d’une machine. Le CAB 2000 était plutôt faible dans tous ces domaines : s’il pouvait effectuer une addition en 0,5 milliseconde, il lui en fallait 15 (un demi-tour de tambour) pour accéder à une case de mémoire sur le tambour.
L’exécution d’instructions rangées à la suite sur une piste de tambour prenait donc un temps disproportionné par rapport aux capacités opératoires. D’où l’idée d’ajouter une mémoire d’accès quasi instantané, que le programmeur pourrait utiliser à son gré, en y mettant des données ou des programmes.
Pratiquement, ces mémoires de faible capacité (64 mots sur le CAB 2000), étaient réalisées par des tores de ferrites organisés en matrices, chaque tore pouvant recevoir un chiffre binaire identifié par le sens du magnétisme de l’anneau, lui-même créé par les impulsions électriques qui traversaient chaque tore. Cet enregistrement n’était pas permanent et disparaissait avec l’arrêt de la machine : seules étaient conservées les informations contenues par le tambour magnétique.
Cette structure existe encore de nos jours sur les ordinateurs modernes, mais la capacité de la mémoire rapide (RAM) se chiffre maintenant en centaines de millions de caractères ! En 1956, il fallait se débrouiller avec ces 63 mots, pouvant stocker autant d’instructions ou environ 500 chiffres numériques. Notre CAB devait, lui, recevoir une mémoire rapide plus importante puisqu’elle disposerait de 1024 mots de 26 positions binaires.
Installé dans le bureau des ingénieurs qui mettaient au point les logiciels de base du futur ordinateur, je participai à la mise au point du langage du CAB 3026, qui devait être spécifique à cette machine. On parlerait maintenant de langage machine, ou assembleur chez IBM (chaque instruction rédigée par le programmeur correspond à un mot de mémoire et représente une opération exécutable par les circuits de la machine).
Il fallait notamment programmer les « ordres initiaux » de la machine, c’est-à-dire les programmes rangés en permanence dans la machine et qui interviennent pour sa propre gestion - aujourd’hui, on appelle cela le système d’exploitation. Ces programmes démarrent automatiquement lorsque l’on lance la machine et assurent ensuite le fonctionnement des programmes d’application.
L’un de leurs rôles était de traduire, lors de l’entrée d’un nouveau programme, les instructions exprimées avec des lettres et des chiffres décimaux, en mots binaires de 26 chiffres. De même, ils traduisaient les nombres décimaux en nombres binaires purs et, à l’inverse, retraduisaient les résultats en décimal pour la sortie des résultats.
La conception générale de la machine était géniale, largement en avance sur son temps. Elle utilisait déjà des modes de fonctionnement qu’IBM ne devait annoncer triomphalement que plusieurs années plus tard. La SEA avait en fait inventé ce qui s’appellerait plus tard la « mémoire virtuelle » : les programmes, pour s’exécuter dans un laps de temps raisonnable, doivent se trouver dans la mémoire rapide, malheureusement coûteuse à l’époque et par conséquent de faible capacité en espace disponible. Les programmes archivés sur le tambour, étaient donc transférés en blocs d’une centaine d’instructions vers la mémoire rapide et exécutés à partir de celle-ci, en bénéficiant de ses faibles temps de réponse. Le programmeur n’avait pas à se soucier de ce processus et pouvait travailler comme s’il bénéficiait de la totalité de l’espace du disque, mais presque à la vitesse de la mémoire rapide.
Ce système existe toujours, même sur les micro-ordinateurs, où l’on peut augmenter la taille de la mémoire de travail d’un complément « virtuel » pris sur le disque.
En attendant la livraison
Une fois le stage à la SEA achevée, il fallait préparer l’arrivée de la machine. Les locaux étaient déjà bien avancés, la climatisation installée au sous-sol, prête à souffler de l’air froid sous les machines, à travers les ouvertures faites dans le sol à l’emplacement des futures armoires. Il restait à préparer les traitements, ceux du dépouillement du recensement de l’agriculture, première mission du CAB, et prétexte de son acquisition.
En discutant avec le personnel qui recevait les commandes des tableaux statistiques imaginés par les administrateurs de l’Insee, une constante essentielle apparut, l’inconstance des statisticiens, dont les demandes évoluaient sans cesse, obligeant de refaire les travaux antérieurs sous des formes différentes. De ce fait, il n’était pas envisageable d’écrire un programme différent pour chaque nouveau type de tableau. Il fallait plutôt fixer la trame d’un programme général, que l’on pourrait adapter à chaque demande à l’aide de tables extérieures au programme.
Le dépouillement statistique pouvait être organisé en trois phases de traitement.
Dans une première étape, il fallait coder les données. Soit, elles se présentent déjà au départ sous la forme de code, par exemple « 1 » ou « 2 » pour le sexe de l’exploitant agricole, et le travail est déjà fait. Soit, ce sont des valeurs (la surface de l’exploitation en hectares, le nombre de bovins, etc.), et il faut alors attribuer un numéro de tranche (par exemple « 1 » pour les surfaces inférieures à 1 hectare, « 2 » de 1 à 5 hectares, etc). A l’issue de cette étape, toutes les données servant de critère de ventilation sont complétées d’un nombre-code servant à leur classement ultérieur.
La deuxième étape consiste à ventiler en mémoire les données à totaliser, dans des emplacements calculés à partir de ces codes, qui définissent la ligne et la colonne où cette donnée doit être cumulée. La totalisation dans les cases du tableau porte soit sur le nombre d’unités statistiques, en l’occurrence le nombre de cartes, soit sur des montants, par exemple des surfaces ou des revenus. Les tables détaillant la nature du tableau doivent donc prévoir la nature des données à totaliser et les critères à utiliser pour calculer l’adresse de la case du tableau. Les cartes étant triées une fois pour toutes selon un seul critère (par ordre géographique par exemple), il est ainsi possible de traiter chaque donnée de base en ventilant ses rubriques dans plusieurs tableaux différents. À chaque rupture géographique, les tableaux bruts obtenus sont extraits sur une bande magnétique pour traitement ultérieur et les cases du tableau sont remises à zéro pour l’entité suivante.
La troisième étape reprend les tableaux bruts et les met en forme pour publication, soit pour les imprimer, soit, dans le cas du CAB, pour les enregistrer sur microfilm.
Je réalisai à titre de maquette les deux premières étapes et reportai à plus tard le traitement de la troisième, le temps de mieux connaître le fonctionnement du numérographe. Les programmes fonctionnaient à partir de tables désignant, sous forme paramétrée, les codifications à effectuer puis les critères à prendre en compte pour les ventilations en mémoire. Ce schéma correspondait bien à l’objectif de souplesse, puisqu’il suffisait de rentrer ces tables en mémoire pour adapter, sans autre intervention, le fonctionnement du programme de dépouillement à la nature des travaux demandés.
Il ne me manquait plus que la machine pour commencer mes essais. C’est là que les difficultés ont commencé !
A suivre…
------------------------------------------------------------
La matrice de Léontieff estimée de nuit dans un laboratoire de l’armement
Pour faire mes premiers pas en programmation sur un CAB 2000, un administrateur de l’Insee m’avait mis en relation avec le Service des études économiques et financières au ministère des finances, le SEEF.
Le service se livrait à des calculs complexes de macroéconomie et cherchait à « modéliser » le système des achats et des ventes de l’ensemble de l’économie du pays à partir du tableau d’échanges inter-secteurs, plus connu sous le nom de « matrice de Léontieff ».
L’économie nationale était divisée en une centaine de secteurs, chaque secteur utilisant la production des autres secteurs (ou des produits importés) et fournissant des produits destinés à la consommation finale et aux besoins des autres secteurs. Des coefficients techniques indiquaient la part de besoins intermédiaires de chaque secteur dans chacun des autres. Connaissant au départ le volume des importations possibles et les besoins de la demande finale, le modèle permettait de calculer la part de production que chaque secteur devait réaliser pour satisfaire à cette demande.
Sur le plan pratique, le calcul des coefficients technique supposait de résoudre par itération un système de cent équations à cent inconnues, en tenant compte du fait que les machines avaient à peine la place pour archiver en mémoire les données de départ, et, par conséquent, pas celle de stocker les résultats intermédiaires de chaque itération. En programmant, il me fallut donc prévoir de sortir au fur et à mesure sur bande perforée les résultats intermédiaires de chaque itération et de relire cette bande au passage suivant.
Il fallait ensuite une machine. Un laboratoire de l’armement, client de la SEA, accepta de me prêter son matériel. Je m’y rendis de nuit car les temps de machine disponibles étaient rares. Après quelques essais sur modèle réduit, j’entrepris de m’attaquer à la résolution des 100 équations. Un cas imprévu fit échouer la première tentative. Une autre nuit fut nécessaire, après correction du programme et une dizaine d’itérations. Le résultat sembla intéresser le SEEF et rendez-vous fut pris pour poursuivre l’expérience lorsque le CAB serait installé !





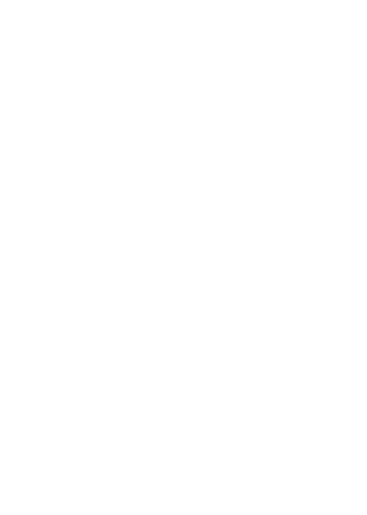
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.