
Paris, place financière ? C’est fichu ! Sauf si…
Paris peut-il encore garder sa place à côté de Londres dans le domaine financier ? Ou sera-t-elle marginalisée, comme l’ont été il y a une génération les places financières de Lyon ou de Lille, face à Paris ? L’enjeu est important et mobilise fortement, sous la conduite efficace de Paris Europlace. L’industrie financière est le premier employeur privé en France, loin devant des industries aussi emblématiques que l’agroalimentaire et l’automobile. Elle donne à Paris le deuxième rang européen derrière Londres, à égalité avec Francfort.
Une avance de Londres écrasante
Mais l’avance de Londres semble écrasante : elle domine dans les fuseaux horaires européens ; la plupart des grandes banques internationales y sont présentes. Dans le domaine de la banque d’investissement, si important parce qu’à très forte valeur ajoutée, l’écart est criant : 25 000 emplois à Paris, 196 000 à Londres ! Il serait plus fort encore si on incluait dans le décompte les services liés, tels les cabinets d’avocats, le courtage, l’assurance, l’immobilier ou le négoce.Les sceptiques le disent : l’écart va se creuser encore, sous l’effet de trois facteurs :
- D’abord, l’industrie financière bénéficie au plus haut point d’effets de cluster ou de grappe industrielle, où la simple proximité géographique est créatrice de valeur. Les marchands de chaussures qui s’installent dans une même rue le savent bien. La finance industrielle aussi. Quand une banque d’investissement s’implante à Londres, elle trouve immédiatement une main-d'œuvre abondante dans ses métiers, une variété très grande de services liés, un cadre juridique et réglementaire éprouvé… bref, tout un écosystème réduisant les coûts de développement et facilitant des offres nouvelles. L’effet grappe l’emporte sur l’effet concurrentiel.
- La langue anglaise ensuite. Quand dans beaucoup de domaines, on est en route vers la langue unique, l’économie qui dispose déjà de l’infrastructure (la communauté des anglophones) a un avantage. L’industrie financière, qui requiert les moyens les plus sophistiqués de communication, en tire partie.
- Le gouvernement britannique enfin, que sa tradition non interventionniste n’empêche pas de promouvoir encore et toujours la place de Londres. La dernière initiative de Gordon Brown, ministre des finances britannique, est marquante : elle consiste à faire une sorte de Londres Europlace, ou plutôt de London Worldplace, réunissant tous les grands acteurs de la place, britanniques comme étrangers , pour forcer le pas et viser la domination mondiale.
Le succès de Londres bâti sur une rupture innovatrice
L’avance est-elle irrémédiable ? Un peu d’histoire importe ici. Londres tire son succès en finance d’une double tradition très ancienne. Celle des marchands, amplifiée par l’expansion coloniale du pays ; celle du droit et de la stabilité politique. Ce second facteur a par exemple permis dès le XVIe siècle, fait fondateur souvent oublié, le financement des guerres via les marchés financiers . Le décor était planté : à l’époque, la France recourait à l’impôt ou à l’emprunt forcé gagé par l’impôt, l’Angleterre aux marchés financiers ! Mais tout cela était bien loin au sortir de la deuxième guerre mondiale. L’économie britannique était très faible. Si Londres restait favorisée par sa culture financière et sa communauté d’intérêt avec les Etats-Unis, l’économie allemande et même la française avaient pris le pas sur elle dès les années 60. Or, le développement des places financières suit toujours celui du commerce. Amsterdam, Chicago, Tokyo ou Singapour en témoignent. Selon ce fil historique, la capitale financière européenne aurait dû se trouver à Francfort ou Hambourg, dans un pays aux exportations considérablement supérieures et aux entreprises bien plus conquérantes. Pourquoi donc Londres ?
Ce qui explique son remarquable retour, en simplifiant à peine, c’est une innovation financière simple mais majeure, celle des euromarchés . Dans les années 70, sous l’initiative de banques américaines localisées à Londres, et avec l’accord implicite des superviseurs londoniens, le marché de l’eurodollar a démarré. C’était un marché offshore où les établissements de crédit pouvaient s’échanger des créances monétaires en dollars en échappant au monopole de la FED, banque centrale des États-Unis, sur l’émission de sa monnaie. L’innovation était accessoirement technique, essentiellement réglementaire, et allait être suivie de beaucoup d’autres. Elle mélangeait une ouverture aux intervenants étrangers, une régulation ouverte à l’innovation et, bien sûr, une bonne intuition de ce qu’allait impliquer le retour de la prospérité en Occident, à savoir la mondialisation du marché des capitaux.
Face à ce pragmatisme, Francfort et Paris ont failli. Le projet européen suffisait à occuper les gouvernements, et la phrase de de Gaulle, somptueuse mais vaine, marquait la classe politique : « La politique de la France ne se fait pas à la corbeille ». Ce détour historique est là pour souligner une évidence : face à la force de Londres, il est naïf de penser que revenir à niveau est seulement affaire d’efforts d’investissement ou de sollicitude du gouvernement. La seule fenêtre ouverte serait celle d’une rupture technique majeure, comme celle dont a su bénéficier Londres en son temps, et qu’il s’agirait d’exploiter à fond.
Une nouvelle rupture : celle de la finance quantitative
Or nous y sommes ! Elle est devant nous, avec l’irruption depuis une ou deux décennies de ce que j’appelle la « finance quantitative », fondamentalement basée sur la gestion statistique du risque, avec des techniques réservées jusqu’à présent à l’assurance, à base de probabilités, de modélisation et de techniques d’ingénieur. Pour la caractériser, on peut dire que la gestion du risque des actifs prend le pas sur leur financement. Les trois façons de se protéger du risque, couverture, diversification et assurance, convergent. Cette rupture est d’origine universitaire, avec à la clé tout un chapelet de prix Nobel : la compréhension du rôle de la diversification et de l’arbitrage sur les prix des actifs financiers (Markowitz, Sharpe) et leur application à la finance d’entreprise (Modigliani, Miller) ou à la valorisation des actifs dérivés contingents (Merton, Black et Scholes). Cette dernière étape est probablement la plus importante parce qu’elle a permis l’essor des marchés de dérivés. Il devenait possible, comme dans l’assurance, de se protéger des risques financiers à large échelle sans entraîner de transfert de propriété de l’actif à couvrir.
Depuis, les produits "quantitatifs" irriguent tous les domaines de la finance. D’abord, l’industrie de la gestion de l’épargne, parce qu’ils permettent à l’investisseur d’accéder à de nouvelles classes de risque économique et de faire éclater ce risque en quantité de supports financiers aux propriétés différentes. Les banques en font désormais un usage quotidien, autant pour couvrir leurs risques de crédit que les transférer ou plus simplement les mesurer . Il en va de même pour les assureurs. Par nature, ils auraient dû être en avance sur les banques dans la gestion quantifiée du risque. C’était pourtant l’inverse qu’on observait à compter des années 80. Eloignés des marchés financiers, bien nourris par les revenus de placements qu’offrait le contexte de taux d’intérêt élevés, ils étaient moins ouverts aux innovations dans la gestion de leurs risques d’assureur. Depuis, ils font un retour en force, empruntent aux banques leurs mesures de capital à risque, et en tirent les conséquences sur leurs politiques tarifaire et commerciale. Les risques santé et surtout vieillesse multiplient les champs d’application.
Un dernier domaine, plus complexe et moins facile à quantifier, s’ouvre lui aussi à ces techniques : la finance d’entreprise. Beaucoup des engagements au bilan de l’entreprise, tels les obligations à l’endroit du personnel ou les différentes classes de dette, relèvent de cette approche. De nouvelles techniques de valorisation se font jour, avec les options réelles et les simulations stochastiques de flux de trésorerie. Les normes comptables IFRS accélèrent le mouvement, en imposant une valorisation en juste valeur des participations détenues au bilan. Même les risques opérationnels, ceux que traquent désormais les contrôleurs internes des entreprises au titre des réglementations Sarbanes-Oxley ou LSF, se prêteront de façon croissante à des approches formalisées… La porte s’ouvre sur des territoires immenses.
Paris retrouve ses chances
Ici, le travailleur emblématique n’est plus le courtier ou le chartered accountant comme dans le Londres traditionnel ; c’est désormais l’ingénieur ou l’actuaire, décor où Paris retrouve certains avantages. Le quantitatif convient bien à la forte culture d’ingénieur de notre système universitaire. C’est ce qui explique que le métier du trading d’options a bien pris souche à Paris. (Pour l’anecdote, Société Générale a monté dans les années 80 un département options. Le produit existait de longue date. L’innovation réelle, dont on peut légitimement crédité l’initiateur de cette activité, Antoine Paille (Ensae1977), consiste à avoir mis la gestion du risque au cœur du processus de production. Le reste de la place, y compris à l’étranger, a copié le modèle. Celles qui n’ont pas su faire n’existent plus, tel Indosuez. Tout ceci s’est fait à moment où la réglementation française interdisait encore l’usage des dérivés !)
A présent, les effets de grappe jouent leur rôle vertueux. Le métier est conforté par des années de réglage industriel des fonctions de trading et de contrôle. Et le marché du travail acquiert une certaine profondeur, même si beaucoup de ces talents circulent entre Paris, Londres et New-York (les « French quants »). Société Générale et BNP Paribas ont probablement à se féliciter que Calyon ou demain Natixis leur fassent sérieusement concurrence dans les dérivés actions, y compris en débauchant leurs cadres, parce que l’effet grappe l’emportera. Dans le domaine de l’assurance vie, Axa a su, par ses acquisitions aux États-Unis, combiner l’innovation marketing du marché américain et la technicité de ses « quants » français. Il serait judicieux pour Allianz, via sa filiale AGF, de suivre la même voie.
Disons-le fortement : bien exploiter l’atout quantitatif est l’unique chance qui reste à Paris de revenir dans la course. Si beaucoup de mesures peuvent être prises, il faut un axe stratégique simple et s’y tenir. Le bon axe est la promotion sans relâche des capacités quantitatives de la place de Paris, d’autant que Londres ne reste pas inerte. Je mentionne ici trois angles sous lesquels cette stratégie peut être poursuivie : une ouverture large du marché à tous les intervenants, un meilleur usage qu’aujourd'hui de la réglementation et, pour faire le lien avec la seconde partie de ce numéro de Variances, un vrai soutien à la formation .
Ouverture, ouverture
Cohérente avec son modèle d’ouverture extrême, Londres accepte l’extraterritorialité des acteurs économiques. Elle fournit le court de tennis ; aux joueurs de s’y présenter. Il est fascinant de voir que quasiment toute l’industrie de la banque d’investissement londonienne n’est plus à capitaux britanniques, ce qui ne va pas sans difficultés politiques, notamment au vu d’une certaine hypertrophie du secteur financier par rapport au reste de l’économie. Mais l’effet grappe compense et fait taire les dissensions.
Aussi, il importe d’encourager systématiquement l’implantation parisienne des banques étrangères en finance quantitative. Le modèle est HSBC, qui fait confiance à ses équipes parisiennes de l’ex-CCF dans les dérivés actions. Une des missions premières de la Fédération bancaire française devrait être de faire du commercial pour attirer à Paris les concurrents étrangers. Elle vérifierait à quel point les intérêts communs l’emportent, notamment en capacité de lobbying. Cette vue large est encore minoritaire, et le soutien aux initiatives de Paris place financière n’est souvent que le souhait « patriotique » de garder les positions acquises.
Un cadre réglementaire performant
On est à deux doigts ici de gâcher la seule chance crédible qui reste à Paris. Une réglementation doit être lisible et stable, pour donner au marché sécurité et liquidité ; elle doit aussi laisser place à l’innovation. Dans cet équilibre entre sécurité et innovation, le bilan parisien est médiocre, malgré la qualité individuelle de nos régulateurs. Il y a cinq ans, un malheureux rapport de l’AMF, l’autorité des marchés financiers français, fustigeait le rôle de la gestion alternative et des hedge funds. Ils sont pourtant, sans exagérer, au cœur de la nouvelle gestion quantitative de l’épargne. Pas assez économistes, trop sûrs d’eux, les régulateurs de l’époque ont handicapé ces métiers. C’est finalement à Mayfair, un quartier de Londres, qu’ils ont filé. Il est désolant de lire ce jugement d’un professionnel bien informé de la City, Paul Myners, ancien de Goldman Sachs et actuel dirigeant de Marks and Spencer : « Plus aucun autre centre financier européen ne peut espérer encore concurrencer [Londres]. Francfort et Paris ont perdu leur dernière opportunité quand ils ont tourné le dos aux hedge funds. » Souhaitons que ce soit faux. En tout cas, il faut bouger vite. En est-on toujours conscient à Paris ?
Il faut alléger le cadre réglementaire s’appliquant aux fonds d’investissement, dès lors qu’ils ne font pas appel public à l’épargne. Il faut moins de régulation lorsque les parties contractantes sont professionnellement bien informées. On étouffe l’innovation si on lui fait porter trop vite le poids sécuritaire qui s’impose aux produits largement distribués. A quoi servira-t-il à l’épargnant français d’avoir un cadre très sécurisé, si demain ses prestataires sont contraints d’aller à Londres pour se fournir en produits, ceci sous droit britannique ? Les fonds, dira-t-on, arrivent à prospérer à Londres et New-York, où interviennent la SEC, autorité de marché américaine, et la SFA, autorité britannique, deux institutions aux épaules larges . C’est vrai et c’est la preuve que l’AMF (ou la Commission bancaire) sont souvent plus restrictives qu’elles. Dans notre situation de fragilité industrielle, pourquoi ne pas adopter pour principe que les règles ne peuvent être plus sévères que celles en usage dans la City ou à Wall Street, sauf argument très puissant ? Puisqu’au fond, on est sur une question d’arbitrage entre rendement et risque, pourquoi le régulateur, sous impulsion du politique, n’élargirait-il pas sa tolérance au risque pour la place de Paris ? C’est sans doute heurter la forte culture administrative française que d’évoquer une stratégie d’ « offshorisation » de la place de Paris, mais le débat mérite d’être posé. Sans dramatiser, l’alternative risque d’être entre réguler moins, ou ne plus réguler du tout, faute de matière à réguler. Y a-t-il un régulateur à Lille ? Ceci permettrait l’émergence d’une foule de prestataires dynamiques, à la périphérie des grandes banques, souvent gérés en partenariat par d’anciens banquiers, sur un modèle qu’on voit par exemple à Boston, et qui au vrai caractérise le mieux ce qu’est une grappe. Ce modèle s’applique parfaitement à la gestion d’actifs. Il vivifie le marché du travail, à la fois en interne pour les banques et pour la communauté financière. Un tel modèle pourrait émerger dans les métiers de la banque d’investissement (il le fait déjà pour sa partie fusions-acquisitions).
La formation
Antoine Paille, déjà cité, remarquait plaisamment que toutes les trouvailles de la finance théorique des années 60 et 70 auraient pu être découvertes à l’ENSAE (autant que dans le département économie de l’Université de Chicago) si seulement les talents mathématiques dont l’école disposait avait pu être mis sur le sujet . Vrai ou faux, cela met en évidence l’importance de la formation. Le gouvernement souhaite que les efforts se regroupent dans l’enseignement de l’économie. Il faut le même effort en finance, plus exactement en économie financière, sachant que les deux disciplines ne peuvent être dissociées et que la finance quantitative ne se limite pas à une bonne maîtrise du calcul stochastique.
Le débat est ouvert à ce sujet. Faut-il la création d’une n-ième école, au risque de déstabiliser les institutions qui y excellent déjà (Paris VI, ENSAE, Toulouse …) ? Ne faut-il pas leur donner des moyens accrus, notamment en permettant des financements privés et sans cette barrière malthusienne et archaïque entre grandes écoles et universités ? Je suggère ici une réforme simple dans son principe, mais ambitieuse pour notre enseignement supérieur bien congelé. Elle consiste à copier pour nos universités l’excellente loi sur le mécénat que le gouvernement a fait voter en 2003, et qui met la France à la pointe des pays en ce domaine. Selon cette loi, et pour simplifier, toute dépense de mécénat est déductible d’impôt à un taux quasi-double, 60%, au lieu du 35% standard. La mesure reprendrait l’idée, prévue par la loi sur le mécénat, que ces dépenses sont justifiables de contreparties au donateur dans certaines limites (25% de la subvention), sous forme de recherches, prestations ou stages rendus par l’institution. L’intérêt de la réforme serait que la communauté bancaire pourrait mettre au pot, pas uniquement d’ailleurs vers les départements d’économie ou de finance. Une réforme de ce type pourrait s’appliquer aux personnes physiques, comme pour la loi sur le mécénat. Ce ne serait pas le plus mauvais usage des gras bonus de la communauté financière qu’ils aillent aux établissements d’enseignement, sur le modèle des subventions versées par les alumni des grandes universités américaines…Ne saurait-on faire pour la formation ce qu’on fait pour la culture, quand les enjeux industriels sont si grands ?





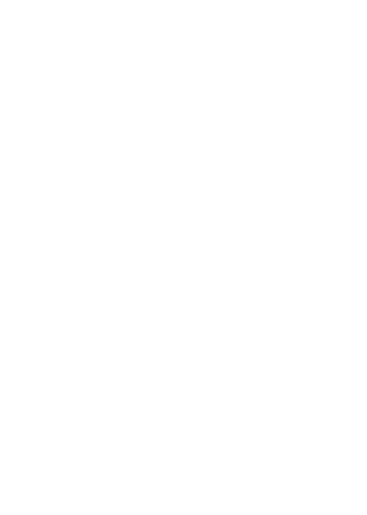
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.