
De l’évaluation à la gestion des risques dans le domaine alimentaire : Comment prendre en compte le contexte économique et social ?
Les multiples crises alimentaires des années 90 et notamment la crise de la vache folle de 1996 ont conduit le législateur à mettre en place en 1998 un dispositif nouveau pour mieux gérer ces risques et tenter d’éviter de nouvelles crises de grande ampleur ou du moins d’en limiter les conséquences négatives. Ce dispositif est basé sur le principe fondamental de la séparation des missions d’évaluation et de gestion des risques. L’évaluation des risques est un processus scientifique et collectif en quatre étape : identification des dangers, appréciation des effets, appréciation de l’exposition, estimation des risques. La gestion des risques telle que décrite au niveau international par le Codex Alimentarius ou en France par l’AFNOR est un processus visant à prévenir et maîtriser le risque, en considérant à la fois les résultats de l’évaluation du risque et les considérations économiques ou sociales. La gestion du risque est étroitement liée à la communication sur le risque. L’idée générale à la base de cette séparation est de privilégier l’indépendance et la transparence du processus d’évaluation scientifique des risques. L’évaluation des risques ne doit pas prendre en compte de critères socioéconomiques pour ne pas être tentée de relativiser des risques quand les enjeux économiques sont trop importants. Réciproquement, les gestionnaires des risques ne doivent pas évaluer eux-même des risques pour lesquels il seraient juge et partie. Le rapport Kourilsky-Viney sur le principe de précaution [1] a beaucoup contribué à définir cette séparation. Mais en pratique comment peuvent s’articuler évaluation et gestion des risques, surtout en temps de crise et en particulier quand les données scientifiques sont insuffisantes ? Pour répondre à cette question, il faut préciser ce que l’on entend par évaluation des risques et la façon dont on la conduit.
Les dispositifs d’évaluation des risques sanitaires
L’évaluation des risques est un processus scientifique qui consiste dans une première étape à identifier les dangers qui peuvent nuire à la santé humaine. La seconde étape vise à comprendre les conséquences de ces dangers. Dans le domaine de l’alimentation ces dangers sont d’ordre microbiologique, physico-chimique ou nutritionnel. Dans les troisième et quatrième étape, le calcul statistique de l’exposition des populations à ces dangers et l’appréciation ou estimation du risque c’est à dire des probabilités d’occurrence des diverses conséquences négatives des dangers doivent permettre de relativiser les dangers entre eux et d’informer le gestionnaire du risque de la nécessité de prendre ou nom de nouvelles mesures pour protéger les consommateurs. La loi du 1er juillet 1998 a confié cette mission d’évaluation des risques alimentaires à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, l’Afssa, établissement public gérant dix comités d’experts spécialisés et regroupant les laboratoires de recherche et d’appui technique de l’ancien Centre National d’Etudes Vétérinaires et Alimentaires (CNEVA). L’indépendance de l’expertise e l’Afssa est garantie par une démarche de mise sous assurance qualité. Les experts de l’Afssa ont été recrutés par un appel d’offres à candidature principalement auprès des établissements publics de recherche. Ce sont donc des experts externes de disciplines et d’origines diverses. Ils ont été sélectionnés selon une procédure transparente basée sur des critères vérifiables : discipline scientifique, publications, pratique antérieure de l’expertise. La démarche d’évaluation des risques est basée sur des processus écrits et détaillés comprenant des étapes clés comme la transmission d’une saisine à l’Afssa par un ministère ou une association de consommateurs, la préparation d’un dossier par un ou plusieurs rapporteurs, le débat contradictoire en comité d’experts pluridisciplinaire permettant de mettre en évidence d’éventuels désaccords. Un soin particulier a été apporté aux déclarations d’intérêt des experts et à la non participation aux délibérations des scientifiques ayant un intérêt économique ou politique dans un dossier. Par exemple, quand un scientifique a un contrat de recherche avec un industriel, il ne peut participer
Les spécificités du risque alimentaire
Cette démarche est elle généralisable à d’autres risques ou bien existe-t-il une spécificité de l’alimentation qui conduise à une organisation particulière de l’évaluation et de la gestion des risques ? Plusieurs observateurs ont souligné quatre aspects particuliers du domaine alimentaire par rapport à d’autres secteurs où la même démarche d’évaluation des risques existe. D’une part, les marchés alimentaires comprennent un très grand nombre d’aliments (plusieurs centaines de milliers de références) dont l’innocuité ne peut pas être testée systématiquement a priori. Cette multiplicité des aliments et ingrédients complique la démarche d’évaluation et notamment l’étape du calcul statistique de l’exposition totale, tous aliments vecteurs ajoutés. Dans le cas de l’ESB et du nouveau variant de Creutzfeld-Jacob, l’évaluation des risques n’a jamais pu se baser sur des données précises car il n’a jamais été possible d’estimer le nombre de consommateurs exposés selon leur niveau d’exposition. En effet, avant 1996, les produits d’origine bovine ayant pu véhiculer le nouveau variant étaient nombreux, sous forme d’ingrédients comme les viandes séparées mécaniquement (VSM) dont la traçabilité n’avait pas été assurée. L’appréciation quantitative des risques (AQR) reste encore un domaine de recherche en alimentation, notamment en microbiologie. Le grand nombre de références alimentaires complexifie également la gestion des risques et notamment les contrôles. D’autre part, il n’existe pas de bénéfice santé ou autre d’un aliment qui puisse contrebalancer un risque. Tout aliment est substituable à un autre et la mise en évidence d’un risque alimentaire peut conduire à la pénalisation rapide du produit incriminé. C’est notamment le cas pour les crises récurrentes de listériose. Même si le nombre de victimes est en général heureusement faible, il est obligatoire d’informer largement les consommateurs de l’existence d’une contamination afin que les aliments vendus ne soient pas consommés. Un effondrement des ventes est alors difficilement évitable. Les enjeux économiques sont donc immédiats. Autre spécificité, les psychologues et sociologues de l’alimentation ou des risques tels que Rozin [2] ou Fischler [3] ont mis en évidence que la sensibilité des consommateurs aux risques véhiculés par les aliments est souvent plus forte que pour d’autres vecteurs en raison de différents facteurs aggravants : incorporation de l’aliment dans son propre corps, dimension symbolique et culturelle forte, invisibilité des toxiques alimentaires, méconnaissance des modes de transformation des aliments, réaction à la modernisation des procédés et idéalisation des aliments traditionnels. Enfin, et ce point a été relativement peu mis en avant jusqu’à présent, l’alimentation est un large domaine comprenant un très grand nombre d’acteurs différents : agriculteurs de diverses sensibilités, grande distribution généraliste, distribution spécialisée, commerçants
Perception des risques, incertitude et décisions publiques
Dans ce contexte où les incertitudes et la réactivité des différents acteurs sont fortes, les évaluateurs peuvent donc se retrouver dans une situation de crise : face à un risque annoncé dans les médias comme par exemple pour la dioxine dans les poulets en Belgique ou le naufrage de l’Erika ou peut-être demain la contamination des ovins par l’agent de l’ESB, ils doivent être en mesure de produire collectivement et rapidement un avis argumenté sur la base d’informations forcément incomplètes. Le prix à payer pour cette réactivité est important. De coûteuses bases de données sur la surveillance des denrées alimentaires permettant d’estimer rapidement des expositions des consommateurs sont nécessaires. L’existence de laboratoires accrédités en mesure d’analyser rapidement les aliments incriminés est également indispensable. Les réflexions se développent aujourd’hui autour de la mise en place d’alimenthèque et de biothèque, c'est-à-dire de bases de données archivées d’aliments et de prélèvements biologiques humains. Comment apprécier à un moment donné la gravité de l’exposition des consommateurs à un contaminant donné si l’on ne connaît pas l’historique de l’évolution de cette exposition ? La crise de l’ESB a démontré clairement le besoin d’archivage des données de surveillance pour mener des analyses rétrospectives. Les coûts de tels dispositifs peuvent se chiffrer en centaines de millions d’Euros. Mais les experts en charge de l’évaluation n’ont pas à arbitrer entre les diverses options de gestion des risques même s’ils peuvent se prononcer en faveur ou défaveur de telle ou telle option. Ils n’ont en général ni les connaissances ni le temps nécessaire à l’évaluation économique et sociale. La difficulté est donc reportée sur le gestionnaire public du risque, instance politique qui doit prendre en compte à la fois les évaluations des experts et les positions des différents acteurs, professionnels et consommateurs et finalement citoyens. Comme d’autres domaines, le secteur de l’alimentation a donc été l’objet d’expérimentations sur les modalités de gestion du débat public en matière de gestion des risques. Rappelons ici les principales modalités expérimentées. Une première modalité proposée notamment par Michel Callon [4] et plusieurs sociologues des sciences est celle du forum hybride qui vise à faire se rencontrer experts et profanes afin que les argumentations des uns et des autres se complètent mutuellement. Le fondement théorique de cet outil réside dans la nécessité pour les experts scientifiques de sortir de leurs laboratoires et de s’ouvrir à la réalité du terrain telle qu’elle est vécue par les intéressés. Un cas exemplaire est le forum ou liste ESB sur internet qui a vu pendant plusieurs années dialoguer de façon permanente des acteurs et citoyens autour du risque ESB et des modèles d’agriculture ou d’alimentation. Cette première
Conclusion
Il faut constater que si un grand effort de rationalisation de l’évaluation des risques dans le domaine alimentaire a été fait au niveau français comme au niveau européen, la prise en compte des dimensions économiques et sociales reste encore peu formalisée et organisée. Les approches coûts-bénéfices classiques apparaissent peu adaptées à la gestion publique des risques, notamment en période de crise. En effet, les citoyens ont leur propre rationalité qui peut conduire à privilégier, à risque constant, une méthode de réduction de risque plus coûteuse qu’une autre. L’interdiction des farines animales devait-elle s’ajouter aux tests systématiques et au retrait des tissus à risque ? Il reste à mieux connaître la rationalité des citoyens qui conduit à préférer telle ou telle option. Dans tous les cas, on ne peut pas reprocher aux citoyens de réagir de façon « irrationnelle » ou parler de « psychose » quand toutes les données du problème ne sont pas mises sur la table fautes de connaissances suffisantes. Peut-on pour autant espérer que l’indispensable transparence et l’amélioration des connaissances sur les risques raréfieront dans l’avenir les crises alimentaires ? La multiplicité des acteurs et des intérêts rend la gestion des crises particulièrement complexe. Dans un domaine où les aspects symboliques et politiques sont très présents, les sujets d’indignation justifiant la médiatisation d’alertes peuvent être nombreux. Dans tous les cas, la responsabilisation croissante des acteurs, notamment sur le plan juridique, rend inéluctable l’accroissement des besoins en expertise non seulement en sciences biologiques ou en épidémiologie, mais aussi en économie et sciences humaines et sociales.








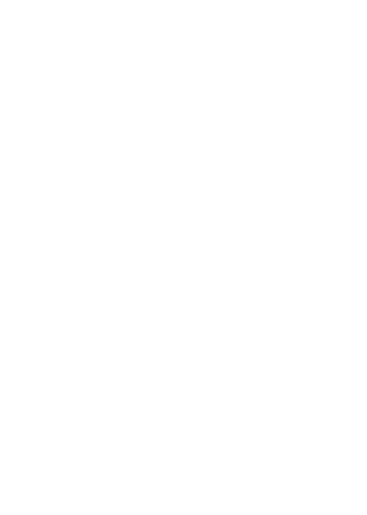
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.