
APRES LA BULLE
L’ajustement des bourses mondiales met en lumière les différents liens que les marchés entretiennent avec le monde réel. Après deux ans de chute des indices et dans le contexte d’un fort ralentissement de l’activité économique, les relations entre les marchés et les dynamiques macroéconomiques sont analysées. Le vecteur principal de l’influence des marchés reste l’effet de richesse, pour les ménages comme les entreprises. Le rôle des politiques économiques est donc central dans la sortie de crise et nécessite beaucoup d’inventivité.
L’éclatement de la bulle boursière de la fin des années quatre-vingt dix constitue un choc formidable pour les économies occidentales. Depuis leur point le plus haut – atteint au printemps de l’année 2000 aux Etats-Unis et à l’automne en Europe - les marchés boursiers ont perdu près de la moitié de leur valeur (un peu moins aux Etats-Unis, un peu plus en Europe). Un tel repli situe la période actuelle dans la lignée des grandes crises boursières de l’histoire du capitalisme, comme la grande dépression des années trente, le choc pétrolier de 1973 ou plus proche de nous le Japon des années quatre-vingt dix.
C’est dire les implications potentielles sur l’activité, l’inflation et le bien être de chacun. Ce qui est en jeu, ce n’est rien moins que le risque d’une déflation généralisée et la faillite d’un système de capitalisme dit « patrimonial », avec son éventuel cortège de répercussions internationales et politiques. Les marchés financiers ne s’y trompent pas puisqu’ils intègrent encore aujourd’hui dans leurs anticipations une probabilité non négligeable que se développe un scénario « à la japonaise » aux Etats-Unis comme en Europe. C’est ce qui maintient par exemple les taux d’intérêt de long terme aux alentours de 4%, un niveau artificiellement bas au regard des perspectives de croissance, et d’inflation en dépit du rapide creusement des déficits publics.
On s’intéresse ici aux conséquences macroéconomiques de l’ajustement des bourses mondiales. Après quelques éléments descriptifs sur l’épisode actuel, on montrera l’importance des effets de richesse dans la dynamique de « purge » qui entrave le rebond de la croissance. Elle suppose en contrepartie une réactivité et une inventivité des politiques économiques pour éviter de basculer dans une dynamique déflationniste.
Une typologie des « bear markets »
On pourrait disserter à l’infini sur les causes du boom et de la chute des bourses. Avec le bénéfice du recul, il ne semble pas faire de doute que l’épisode récent a constitué une des bulles spéculatives les plus marquées de l’histoire récente. Ce qui suggère un aveuglement collectif de l’ensemble des acteurs et observateurs de marché. Par exemple, de 1994 à 1999, le niveau des indices boursiers a triplé aux États-Unis, et doublé sur les principales places financières européennes. Cependant, les « fondamentaux » peuvent difficilement rendre compte de cette envolée des cours : les profits n’ont progressé que de 60% sur la même période.
Mais ce diagnostic n’a pas toujours été aussi clair. Il ne faut pas oublier que l’expansion des indices boursiers s’est accompagnée de performances macroéconomiques exceptionnelles aux Etats-Unis, nourries par de formidables gains de productivité et un boom considérable de l’investissement. Cela suggérait un régime de croissance plus vertueux. Les nouvelles technologies en fournissaient la preuve microéconomique imparable. Par ailleurs, le vieillissement progressif de la population justifiait une montée considérable de l’épargne financière pour financer les retraites. Cet apparent « miracle américain », observable dans les données macroéconomiques, a alimenté et justifié les attentes délirantes de la sphère financière. L’exemple le plus caractéristique de « l’onction » donnée par les économistes au développement fulgurant des marchés est certainement le changement d’attitude d’Alan Greenspan. Après avoir pointé « l’exubérance irrationnelle » des marchés en 1996, le président de la Réserve Fédérale n’a eu de cesse de rappeler sa confiance dans les importants gains de productivité réalisés par l’économie américaine.
Cette thèse du miracle a néanmoins été plus difficile à soutenir en Europe, où les marchés ont finalement progressé plus fortement encore qu’aux Etats-Unis, sans que la productivité ait montré le moindre signe d’accélération. C’est bien une dynamique de croyance collective, autoréalisatrice (et donc parfaitement « rationnelle ») qui a largement contribué à l’essor des bourses.
L’effondrement qui suit l’éclatement de la bulle ne devrait donc pas être rattrapé rapidement. Une analyse purement descriptive des différents types de marchés « baissiers » montre en effet que l’épisode actuel emprunte bien des caractéristiques communes aux corrections structurelles observées dans le passé. Dans son étude exhaustive des chutes des marchés boursiers aux Etats-Unis comme en Europe depuis 1750, P. Oppenheimer distingue trois types de «bear markets » (« Share Despair », 12 décembre 2002, Goldman Sachs, Goldman Strategy Research) :
· Ceux directement liés à un choc extérieur (par exemple la crise asiatique). Ils durent en général moins d’un an et sont corrigés rapidement ;
· Ceux liés au cycle. Ils sont déclenchés par le durcissement monétaire qui accompagne la montée des tensions inflationnistes et prennent fin grâce aux baisses de taux d’intérêt. En moyenne, le repli du marché ne dure pas plus de 2 ans, et le précédent pic est retrouvé dans les cinq années qui suivent.
· Enfin, les corrections structurelles. Ces périodes de baisse marquée sont précédées par une bulle financière et une surévaluation aiguë des actifs. Cette bulle est en général nourrie par la croyance en une « nouvelle ère » déclenchée par une innovation technologique (chemin de fer, électricité, technologie de l’information) ou un changement de paradigme dans la gestion du pays (les « restructurations » du Japon à la fin des années quatre-vingt. Elle s’alimente sur d’importants gains de productivité, mais qui finissent toujours par profiter aux consommateurs. Les ratios d’endettement s’accroissent considérablement. L’éclatement de la bulle fait apparaître d’importants abus de comptabilité des entreprises. L’assouplissement monétaire ne suffit pas à relancer les marchés : la baisse est bien plus prononcée que dans les deux cas précédents. Elle dure en moyenne prés de cinq ans, et il faut typiquement une décade pour retrouver les niveaux qui prévalaient avant la crise.
Quelles conséquences macroéconomiques ?
La bulle est parfois décrite comme la conséquence d’une déconnexion de la sphère financière d’avec la sphère réelle. Dans ce cadre, le retour à la réalité des bourses ne devrait pas avoir de conséquences trop dommageables : les marchés ont progressé sans l’économie, ils peuvent donc corriger à la baisse sans affecter l’économie.
Mais cette approche néglige le fait que la bulle boursière s’est aussi accompagnée d’une bulle macroéconomique. Ce point est le plus marquant aux Etats-Unis, où la dynamique boursière a suscité une sur-accumulation de capital (sur-investissement) et provoqué une baisse massive du taux d’épargne des ménages. Il est alors inévitable que la chute des marchés provoque un repli de la demande intérieure.
En temps « normal », les variations des marchés boursiers ne sont pas si prononcées qu’elles justifient de leur prêter une attention particulière. Mais les enjeux macroéconomiques de la correction récente des marchés sont suffisamment forts pour qu’ils perturbent la dynamique traditionnelle du cycle d’activité. Les ordres de grandeur sont en effet considérables : la destruction de « richesse » liée à la perte de capitalisation boursière depuis le point haut du marché représente près de 70% du PIB aux Etats-Unis et 40% du PIB en Europe ! Même si la propension à consommer ou à investir cette richesse est faible (de 2% à 5% en général dans les estimations standards), l’impact de cet ajustement patrimonial sur la dépense est potentiellement très significatif, de l’ordre de 1% à 3.5% de PIB (sans même compter les effets multiplicateurs).
Du côté des entreprises, la baisse des marchés reflète une baisse des profits anticipés et une augmentation de la prime de risque exigée par les investisseurs. Elle affecte négativement l’investissement car elle traduit une baisse du Q de Tobin. Elle peut aussi se comprendre comme un durcissement des conditions de financement externes, puisqu’il devient plus difficile de lever des fonds sur le marché boursier.
Du côté des ménages, le mécanisme de transmission est le standard « effet de richesse ». Le patrimoine financier des ménages diminue lorsque les marchés d’action baissent. En conséquence, les ménages se sentent « moins riches », et ont tendance à faire remonter leur taux d’épargne. Dans un modèle de consommation du type cycle de vie, on montre aisément que le taux d’épargne dépend négativement du patrimoine net des ménages exprimé en proportion de leur revenu disponible.
Aux Etats-Unis, ce seul effet de richesse supposerait que le taux d’épargne remonte de près de 4 points dans les prochaines années. Les ménages américains sont en effet très exposés aux variations des marchés d’action, soit parce qu’ils détiennent directement des titres, soit parce que le montant de leur future retraite est lié à la valeur des actions détenues par leur fonds de retraite. Environ la moitié des américains est directement exposée au marché boursier à la fin des années quatre-vingt dix. Les fortes variations des bourses ont donc entraîné de fortes variations du taux d’épargne.
Ce phénomène est particulièrement visible dans les évolutions récentes. Le remarquable déclin du taux d’épargne depuis 1994 peut en effet être rapproché de l’expansion sans précédent de la richesse des ménages sur la même période. Alors que le taux d’épargne avait évolué autour de 8% depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il a plongé durant les années 1990 pour atteindre une valeur proche de zéro en 2000 au plus haut de la Bourse. Ce mouvement a coïncidé avec la montée du patrimoine des ménages, qui est passé d’une valeur moyenne de 4.5 années de revenu à environ 6.5 années de revenu (voir le graphe). Mais maintenant que la richesse des ménages est revenue à son niveau initial, sous l’effet du repli des bourses, le taux d’épargne doit lui aussi revenir proche de la valeur qu’il avait avant la bulle, soit donc autour de 8%. Cet ajustement n’a pas encore été réalisé complètement, puisque le taux d’épargne évolue aujourd’hui autour de 4%. La reprise de l’économie américaine sera handicapée par ce nécessaire assainissement du compte des ménages.
En Europe, il est traditionnel d’insister sur le fait que les effets de richesse sont beaucoup plus négligeables. Il est vrai que l’exposition des ménages au marché des actions y est moins importante qu’aux Etats-Unis (près de 3 fois moins) et que la sensibilité des ménages européens aux effets de richesse y est traditionnellement deux fois plus faible (les estimations suggèrent une propension à consommer proche de 2.5% contre 5% en général aux Etats-Unis). Mais l’ajustement des bourses a été si prononcé que l’effet sur la consommation des ménages n’est pas négligeable non plus. Nos propres estimations suggèrent qu’une baisse de 10% des marchés actions se traduit à terme par une remontée du taux d’épargne d’environ ¼ de point.
Par conséquent, la baisse de plus de 60% des marchés boursiers européens depuis la fin de l’année 2000 aura coûté à l’Europe près de 1.5% de consommation en moins sur deux ou trois années. En revanche, l’Europe paraît dans une situation plus assainie que les Etats-Unis, car l’ajustement qui lui reste à faire sur son taux d’épargne ne semble pas insurmontable : tout au plus 0.5% contre les 4 points nécessaires aux ménages américains.
Pression sur les Banques Centrales
On le voit, le fort ajustement des marchés boursiers constitue un handicap sérieux pour le rebond de l’activité. Les périodes de ralentissement économique débouchent en général sur une période de croissance soutenue, mais il sera cette fois ci difficile de répliquer une performance cyclique aussi flatteuse : l’investissement reste contraint par les surcapacités héritées de la bulle, la consommation risque de rester peu dynamique car les ménages doivent reconstituer leur épargne.
Ce contexte conduit à d’importantes difficultés dans la conduite de la politique monétaire. La Fed ainsi que la BCE ont été contraintes d’abaisser leurs taux à leurs plus bas niveaux historiques, sans toutefois parvenir à relancer l’économie. La raison en est simple : l’effondrement des bourses peut être analysé comme un durcissement des conditions financières que compense à peine la baisse des taux d’intérêt.
Ce point est illustré par le durcissement progressif de l’indice des conditions financières. Un indice des conditions financières est construit comme une mesure synthétique des différents canaux monétaires et financiers par lesquels la politique monétaire joue sur l’activité. En pratique, il s’agit d’une moyenne pondérée des taux d’intérêt réels de court et de long terme, du taux de change effectif réel et de la capitalisation boursière exprimée en part du PIB. Les pondérations reflètent l’influence respective de ces différents facteurs sur la croissance.
En général, la baisse des taux de court terme de la banque centrale induit une détente des taux longs, un affaiblissement du change, et une remontée des marchés boursiers – soit donc un assouplissement significatif de notre indice des conditions financières. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, puisque la forte baisse des taux d’intérêt de court terme n’a pu empêcher une détérioration. Le graphique ci-contre décompose pour l’Europe l’évolution de notre indice en ses trois composantes principales : la courbe en rouge (qui mesure le durcissement de l’indice depuis le début du ralentissement, en points de base) est la somme de la contribution liée aux taux d’intérêt, à l’appréciation du taux de change et à la baisse du marché boursier. On le voit, les baisses de taux ont effectivement contribué à assouplir les conditions financières de près de 130 bp, mais elles n’ont pu contrecarrer les effets de l’appréciation de l’euro et de la forte correction sur les marchés boursiers.
Cette situation pose évidemment la question de l’efficacité de la politique monétaire dans un contexte de chute profonde des bourses. Le spectre d’un enchaînement déflationniste « à la japonaise » a donc commence à marquer les anticipations. Avec une inflation très faible, des marchés boursiers en chute libre, des taux d’intérêt à des niveaux maintenant proches de zéro, et le secteur bancaire en difficulté, certains ont évoqué le risque que la politique monétaire n’ait plus aucun levier d’action sur l’économie. Les économies occidentales seraient donc menacées d’une récession durable en cas de nouveau choc sur l’activité.
A ce stade, le scénario de déflation semble néanmoins pouvoir être écarté. Une des raisons principales en est l’absence de bulle marquée sur les actifs immobiliers comparable à celle du Japon de la fin des années 1980. Un éventuel éclatement, consécutif à l’éclatement de la bulle boursière, aurait eu des conséquences extrêmement dommageables sur l’activité et les bilans des banques. Le maintien de cet équilibre précaire suppose une réactivité voire une inventivité des banques centrales confrontées à des situations assez inédites.
La Fed a en fait la démonstration évidente en reconnaissant le risque de déflation immédiatement et en théorisant sa doctrine de réaction : il vaut mieux prendre le risque de « trop » baisser les taux d’intérêt - quitte à les remonter plus tard si l’inflation repart – que de se trouver piégé par la déflation. Par ailleurs, si les baisses de taux courts se révèlent insuffisantes, la Fed pourra recourir à des mesures « non conventionnelles » de politique monétaire, par lesquelles elle peut assouplir les conditions financières. Dans deux interventions importantes, le Président Greenspan et le Gouverneur Bernanke ont explicité que la politique monétaire ne serait pas a court de munitions si les taux courts venaient à descendre jusqu'à zéro. La Fed pourrait dans un premier temps racheter des obligations afin de faire baisser les taux longs et aplatir la courbe des taux. Dans un second temps, elle pourrait même acheter des obligations privées, voire des actions. La situation n’exige pas encore ce genre de réponse, mais il est rassurant de voir que la Fed est pleinement consciente des risques et de ses instruments potentiels, alors qu’il aura fallu près de 10 ans à la Banque du Japon pour commencer à les mettre en œuvre (on ne doute pas non plus de la capacité des Etats-Unis a laisser le dollar se déprécier).
En Europe, la BCE est plus réticente à reconnaître que sa politique devient plus agressive et quelle devra peut-être continuer à l’être. Il n’y a pas non plus de doctrine claire sur la réaction optimale aux éventuelles pressions déflationnistes qui pourraient aujourd’hui affecter l’Allemagne. Mais en pratique, elle a déjà abaissé les taux d’intérêt réels à des niveaux sans précédent et semble prête a assouplir ses taux encore si la situation l’exige. Il faut espérer que la jeune institution monétaire européenne saura réagir avec la même flexibilité que d’autres banques centrales pour éviter au continent une récession provoquée par l’éclatement de la bulle boursière.





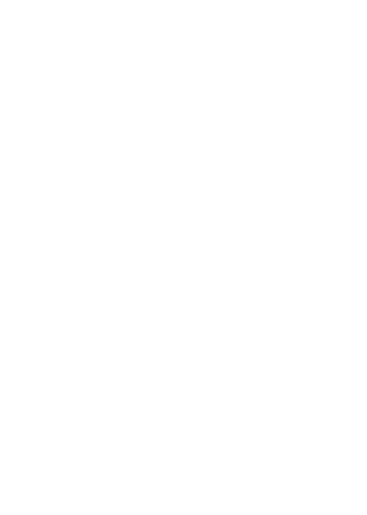
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.