
De la recherche au développement en finance
Dans ce second article, les auteurs constatent que la recherche la plus reconnue en finance et assurance en dehors du monde académique émane des banques centrales et de quelques organismes internationaux, tels que la Banque Mondiale, le FMI ou l’OCDE.
Cela tient notamment à la stabilité des équipes et à des effets de taille, dont ne bénéficient généralement pas les banques et compagnies d’assurance. Les sociétés de services spécialisées jouent de leur côté un rôle de transfert de l’innovation vers les entreprises financières, mais gagneraient à s’appuyer davantage sur la recherche académique pour solidifier leurs méthodologies.
Le développement récent de la finance s’est beaucoup appuyé sur les recherches académiques. La rapide expansion des marchés d’options aurait été difficile sans les références de prix déduites de la formule de Black-Scholes et de ses extensions ; les marchés électroniques se sont beaucoup inspirés des modèles d’appariement d’offre et de demande; la régulation, des travaux portant sur les mesures de risque et leurs propriétés; la gestion de portefeuille, des méthodologies de construction de portefeuilles efficients.
Pourtant, le transfert de technologie ne s’est pas fait de façon directe, c’est-à-dire des chercheurs aux banques et compagnies d’assurance, mais par des circuits assez indirects, par l’intermédiaire :
• de recrutements d’étudiants venant de finir leurs études,
• de conseillers scientifiques académiques, et surtout
• de firmes spécialisées dans ce transfert aussi bien pour les ratings, le contrôle des risques, que la construction de « pricers ».
Ces filières indirectes impliquent souvent des retards et des biais dans le transfert de technologie.
Une absence de recherche dans les banques, les compagnies d’assurance
et les firmes spécialisées
Le niveau de recherche étant maintenant bien mesuré par l’intermédiaire des classements en recherche des universités, centres et entreprises, il est très informatif d’examiner ces classements. Nous avons considéré, dans celui établi par IDEAS incluant Finance et Economie, les 20 % d’institutions les mieux placées dans divers pays, en retenant dans ces classements les institutions non académiques. Les résultats suivants indiquent, pour chaque institution, son classement (ou ses classements, lorsque l’institution a voulu classer divers départements séparément) :
• Etats-Unis (sur un total de 440) : Banque Mondiale (3), IMF (9), (65), Fed. Washington (17), Fed. New-York (28), (31), Fed. Minneapolis (43), (55) Fed. San Francisco (48), Brookings Institution (53), Fed. Philadelphie (64), Rand (77), Inter American Development Bank (94), Fed. Kansas City (95), (106), Fed. Chicago (96).
• Royaume Uni (sur un total de 60) : Banque d’Angleterre (17),
• Canada (sur un total de 30) : Bank of Canada (10)
• France (sur un total de 50) : OCDE (3), (19), (51) Insee (5), Banque de France (12), Centre d’Analyse Stratégique (50).
Ces quelques classements en matière de recherche montrent clairement que seules des banques de type Banque Centrale et quelques organismes internationaux disposent de recherches reconnues. Ces informations peuvent être complétées en considérant les classements individuels des chercheurs. Ainsi au Royaume-Uni, les chercheurs non académiques figurant parmi les 20 % des meilleurs chercheurs britanniques sont essentiellement de la Banque d’Angleterre avec des rangs (72), (189), (229), (365), (383), sur un total de 440. On retiendra de ces chiffres qu’une institution ne peut espérer une recherche de qualité que si elle dispose d’une masse critique de chercheurs, surtout si ceux-ci ne sont pas à titre individuel situés tout en haut des classements.
Il faut noter qu’une telle situation de manque de recherche privée est ici particulièrement marquée. Il existe d’autres industries où les entreprises privées disposent en leur sein de centres de recherche classés, et même en France d’équipes CNRS en interne !
Les nouveaux recrutements
Le recrutement de jeunes venant de terminer leurs études a été une façon de maintenir à jour les techniques utilisées par les banques et compagnies d’assurance. A des niveaux avancés, ces recrutements s’effectuent en master (cas le plus fréquent), soit en deuxième année de Ph. D. en Amérique du nord, soit après une thèse. Recruter essentiellement après master permet effectivement d’introduire les nouveautés enseignées à ce niveau, mais celles-ci restent encore très en retrait de l’état réel des innovations. Il s’agit d’une veille technologique, mais avec un décalage dans le temps. Cette relative inefficacité dans le transfert des innovations n’a pas été complètement ressentie dans l’industrie, car ce mode de veille généralisé n’a pas impliqué de réelles distorsions de concurrence ; par ailleurs, les enseignements de finance ont été régulièrement mis à jour dans les universités et écoles, donnant l’impression d’une matière active (ceci a été moins vrai pour les enseignements d’assurance). Ce n’est que lorsqu’il y avait contact avec les chercheurs, par exemple lors de certaines manifestations ou congrès, que l’écart apparaissait et était à tort souvent interprété comme révélateur d’une recherche trop éloignée des réalités, alors qu’il s’agissait souvent d’un décalage dans le transfert des innovations.
En fait, de tels recrutements au niveau master concernent des gens ayant au mieux bénéficié d’une année de cours spécialisés en finance, ce qui est très peu pour disposer d’une vue d’ensemble des produits, marchés et techniques, apprendre autre chose que des approches de base, et avoir le temps suffisant pour les assimiler. Ceci explique les recrutements en nombre significatif dans les pays anglo-saxons au niveau thèse, mais pas encore usuels en France. Les entreprises françaises ont essayé de résoudre cette difficulté en mettant implicitement en place des formations par la recherche en interne. Celles-ci prennent principalement la forme de petits groupes de recherche-développement et de bourses Cifre. Une fraction significative des nouveaux recrutés obtient son premier poste dans un groupe interne de R et D ; ils y apprennent la mise en place et l’intégration dans l’entreprise des techniques (déjà dépassées) présentées dans leur année d’enseignement spécialisé. Cependant, ils restent souvent autour de 3 ans dans un tel poste, ce qui est trop court pour espérer produire la moindre publication reconnue de niveau recherche.
L’existence de bourses cogérées par les entreprises et les académiques est spécifique à la France. Les entreprises ont clairement préféré des boursiers Cifre en poste chez elles, dont le travail était contrôlable, à des recrutements directs de thésards. Cette solution peut paraître adaptée, mais n’a clairement pas été reprise par les autres pays. Les raisons en sont connues :
• pour bien fonctionner, ce système demande une structure d’accueil de la recherche dans les entreprises, constituée de personnes au fait de la recherche et déjà reconnues, servant de co-superviseurs et assurant les contacts avec le secteur académique, mais aussi d’autres jeunes en préparation de thèse, car ce type de travail est effectué en groupe avec des séminaires réguliers. De telles structures sont rarement en place dans les banques et compagnies d’assurance.
• au début de la mise en place des bourses Cifre, il a été constaté que la qualité des travaux Cifre en finance était en moyenne très inférieure à celle des thésards formés directement par l’université. Cette situation s’est améliorée avec de meilleures sélections des boursiers Cifre et un suivi plus strict du côté académique. Cependant, dès qu’elle a terminé sa thèse Cifre, soit après trois ans dans la firme pour cette préparation de thèse, la personne est très souvent affectée à un service opérationnel. Or, il faut compter de 2 à 3 ans de travail complémentaire pour réussir à publier les résultats de thèse, qui sinon seront perdus. Il suffit de comparer la proportion de travaux publiés provenant de thèses Cifre et de thèses universitaires pour constater que les premières sont quasiment absentes des publications.
La présence dans les classements des banques centrales ou des banques de Réserve Fédérale n’est pas due à leur thème de recherche, qui serait plus économique, mais à leur structure interne, qui rend visibles quelques groupes de recherche-développement, leur donne une taille minimale de l’ordre d’une dizaine de personnes, incluant quelques personnes confirmées (celles que l’on retrouve dans les classements individuels de chercheurs), et surtout leur assure une plus grande stabilité de recherche, d’au moins 5 à 6 ans, et parfois beaucoup plus, au lieu des 3 ans habituels.
Les sociétés de service
Une grande partie des transferts de technologie passe actuellement par l’intermédiaire de sociétés spécialisées (Moody’s, S&P, Fitch pour les ratings, Ernst & Young, KMV Moody’s pour les validations de modèles, pour n’en citer que quelques-unes). Ces sociétés vivent de leur réputation de technicité, disposent très souvent de petits groupes de recherche-développement, publient des séries de notes techniques… Cependant, lorsque certains de leurs travaux sont soumis à des revues scientifiques, ceux-ci passent assez rarement l’étape des rapporteurs extérieurs, pour des raisons très diverses dont certaines apparaîtront plus bas. Clairement, ces sociétés spécialisées, qu’on s’attendrait à voir apparaître dans les classements, n’y figurent pas non plus. Plus grave, de ce fait, les méthodologies qu’elles proposent ne passent par aucune procédure de validation externe, sauf celle très lente du marché.
Deux exemples parmi beaucoup d’autres :
• il aura fallu la crise pour révéler que les agences de rating ne pouvaient convenablement noter les dérivés de crédit complexes. Or aucun cours avancé sur les notations n’évoquait de tels ratings, car il était considéré que ceci était quasiment impossible du point de vue théorique en absence de marché liquide,
• CreditRisk+ est l’un des modèles introduits par le Crédit Suisse pour le risque de crédit et défendu avec un tel forcing qu’il a servi de base à une partie de la régulation Bâle 2. Dès le début, vers 2000, il est connu que certaines de ses hypothèses sous-jacentes sont très erronées (une variable a valeur 0 ou 1, suivant une loi de Poisson, par exemple), et ont des implications sévères sur les calculs de réserve. Ceci est signalé dans divers articles de recherche publiés, mais il faut attendre près d’une dizaine d’années pour que ce modèle disparaisse, non du fait de ces erreurs, mais parce que certains des modèles concurrents sont maintenant utilisés (achetés) par les banques, sans que ces derniers aient eux-mêmes été soigneusement validés de façon externe.
Les sociétés spécialisées ayant vocation commerciale n’ont pas forcément intérêt à introduire immédiatement une nouvelle approche, car il est plus rentable pour elles de fidéliser les clients en donnant l’impression de plusieurs avancées successives. Alors que les résultats de recherches théoriques ne peuvent directement faire l’objet de brevet, ces sociétés vont souvent prendre certains de ces résultats, introduire des terminologies et notations différentes de celles existant dans la recherche, et évidemment ne pas fournir de liste bibliographique des travaux publiés effectués auparavant sur le thème, préférant souvent ne citer que leurs notes internes précédentes. Les grappes de brevets sont alors prises sur le résultat de base et ses extensions. Parfois, cette pratique est si visible que la firme n’ose plus réclamer les royalties sur le brevet, mais elle aura influé de façon parfois intéressante sur la terminologie. Appeler Value-at–Risk (VaR) un simple quantile et expliquer comment le calculer aura assuré à JP Morgan une notoriété certaine ; appeler DeltaVaR la dérivée de la VaR Gaussienne et faire breveter cette dérivée n’aura apporté à Gorman ni renommée, ni royalties. De telles pratiques ont aussi pour ces firmes l’avantage de rendre plus difficile au client l’accès direct à la littérature sous-jacente, donc de le rendre plus dépendant.
Comment les académiques réagissent-ils à ces pratiques ? Leur première réaction a été d’écrire et publier des articles scientifiques critiques sur les méthodologies proposées. Certaines de ces firmes ont immédiatement intenté des procès aux auteurs des articles et éditeurs de revues, au moins dans le système nord-américain. Les conséquences sont importantes :
• des revues scientifiques, même parmi les meilleures, refusent tout article visant à corriger un article paru dans la même revue sans accord de l’auteur de l’article initial,
• les articles critiques continuent à paraître, mais généralement dans des revues non américaines, et avec des co-auteurs ne pouvant pas être poursuivis sous la loi US. Ceci diminue le nombre de critiques et les rend plus difficiles à trouver.
Cependant, dans ce domaine également, la situation s’améliore et les entreprises de service, voyant de plus en plus l’intérêt d’une transparence minimale sur leur pratique, commencent à comprendre que des critiques constructives peuvent améliorer leurs produits. Il est d’ailleurs souvent plus simple pour elles de voir ces critiques émaner des académiques plutôt que de leurs concurrents ou de leurs clients.





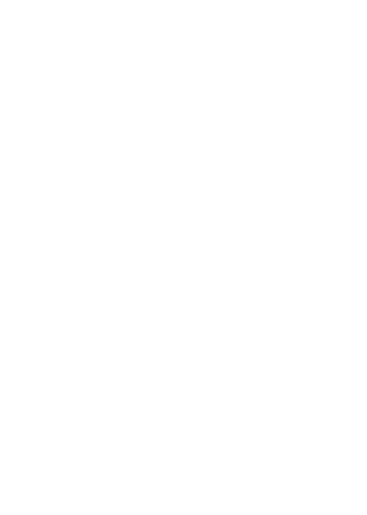
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.