
Faire déboucher l’innovation : de De Gaulle au Capital Investissement
Des bancs de l’ENSAE au private equity, Henri de Lapparent a mené un parcours éclectique, présidant la MNEF ou collaborant au développement de l’INA, il s’est ensuite trouvé au cœur de ce qui deviendrait, une fois structuré, le secteur du capital investissement. Il retrace ici les grandes évolutions de ce métier, avec un regard personnel
Le fil directeur de ma carrière est, depuis plus de 40 ans, l’innovation. Je me suis ainsi intéressé aux éléments facteurs de nouveautés ou de changements, dans la sphère de l’administration ou dans la sphère privée et j’y ai participé activement par le conseil ou le financement des projets.
Les prémices, l’envie d’innovation
Que ce soit à la présidence de la MNEF en 1964-1965, dans le (alors) tout nouveau ministère des Affaires sociales, sous la conduite de Jean-Marcel Jeanneney et sous les ordres notamment de Raymond Barre ou au commissariat du Plan dans le sillage de la « Nouvelle société » menée par Jacques Delors, le fil de ma réflexion (et de ma carrière) a été guidé dès le début par un intérêt très soutenu pour les procédés innovants, qu’il s’agisse de gestion administrative, de l’organisation de la société ou plus simplement des nouvelles technologies développées. Cette caractéristique s’est encore plus affirmée par la suite et elle n’est pas pour rien dans ma participation au développement du capital investissement.
Lorsque j’ai rejoint l’Institut National de l’Audiovisuel, il était un objet composite issu de l’éclatement de l’ORTF qui regroupait quatre fonctions : les archives, la formation, les programmes, et la recherche, pour laquelle je travaillais. La recherche regroupait plusieurs éléments dont le GRM (Groupe de recherches musicales), la recherche en communication sociale (les essais de télévision locale, de télévision interactive), la recherche technologique (les images numériques).
Ni l’audiovisuel ni les télécoms n’avaient alors le poids économique qu’ils ont aujourd’hui, mais il s’agissait déjà d’un front pionnier où l’on trouvait de nombreux projets et des personnes prêtes à se lancer dans des aventures technologiques, économiques et humaines. Nombre de collaborateurs recrutés pendant cette période sont ensuite devenus patrons de sociétés de câble ou de télécoms.
Le financement de l’innovation : de l’investissement public au capital risque
Pour ma part, de l’INA, je suis parti pour la création de l’Agence pour le Développement de l’Informatique, créée suite au rapport Nora-Minc intitulé « L’informatisation de la société ». Il s’agissait, dans le cadre d’une agence publique de soutien à l’innovation, de favoriser le développementde progiciels pour chaque corps de métier, en fédérant des professions et des groupes d’intérêts, en les assistant financièrement et en les incitant à créer des quasi-cahiers de charges pour leurs professions. Je me suis par exemple intéressé à différentes applications des prototypes
de progiciels de gestion dans l’industrie de la chaussure, afin que soient informatisées la conception et le passage de commandes.
Dés lors que l’on s’intéresse à de nouveaux secteurs ou à des activités émergentes et en cours de structuration, la question est la même : quels sont les chantiers d’avenir et comment se prépositionner ? Ces questions, très actuelles, se posaient déjà lorsque je suis arrivé à la CDC avec Robert Lion, que j’avais rencontré au Commissariat Général au Plan. Il m’a confié le développement d’un de ses chantiers d’avenir : la communication.
Ce secteur regroupait les médias et le téléphone au sens français d’alors du terme. Mais que lancer ? Contenus ? Infrastructures ? Dans ces conditions, il faut certes se tenir informé des évolutions institutionnelles et technologiques, il faut surtout savoir saisir sa chance, même si la réussite n’est pas systématiquement au bout. Le plan câble de 1983 nous a ainsi conduits à investir dans les infrastructures, pour se retrouver au final devant un échec partiel : l’infrastructure « câble » peinait à se généraliser, mais elle permettait le développement d’une offre jusque là impossible à acheminer vers les consommateurs.
Cela amorçait une réflexion que tous les groupes de média ont traversé, à savoir « Sommes-nous des gestionnaires d’infrastructure ou des fournisseurs de contenu ? ». Avoir un coup d’avance et sentir le marché était fondamental dans une activité de capital développement qui ne portait pas encore véritablement ce nom et laissait encore largement sa place à l’intuition personnelle. Après m’être retrouvé pour une courte période président de la société de câble rennaise, j’ai pu profiter de mes réflexions sur les contenus. Il s’agissait d’investir dans les contenus de communication, à travers des sociétés non cotées, car Havas était alors la seule société cotée à Paris dans le secteur de la communication. Lorsque la CDC a décidé de regrouper ses participations dans le non coté dans une même filiale j’en suis devenu co-animateur.
J’ai pu m’y concentrer sur mon centre d’intérêt : la communication au sens large, avec les médias, les télécoms et tout ce qu’il y a entre les deux. Pour l’anecdote, le premier dossier étudié fut celui d’un producteur de cinéma qui avait besoin de 200 000 francs pour finir un film : Trois hommes et un couffin. Nous n’avons pas investi dans le cadre de ce dossier, mais l’activité s’est développée avec le montage d’un fonds (In Com) en 1986. Les investisseurs se sont rapidement diversifiés, comptant sur notre bonne connaissance des métiers de la communication en Europe, et le fonds a vite représenté plus de 100 millions de francs.
Peu de concurrents, une équipe constituée pas à pas
Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n’y avait pas en France d’autre équipe spécialisée « communication », bien que ce secteur représentât alors 5 à 6 % du PIB. Il y avait bien les services de croissance externe des grandes entreprises. Mais le capital risque était embryonnaire. L’activité existait déjà outre-Manche et surtout outre-Atlantique, mais sur notre marché nous avions un atout propre : notre approche industrielle des projets et notre connaissance économique et technologique du secteur.
Du fait de notre spécialisation, les Anglais aimaient participer à des projets montés avec nous, même s’ils étaient plus compétents sur le montage.
Au final, nous ne souffrions pas de la concurrence de confrères car nous étions souvent le seul financier du premier tour de table. Et le fait que nous investissions aidait d’ailleurs les entrepreneurs à intéresser d’autres investisseurs, plus généralistes, pour les tours de table suivants. Par ailleurs, nous avons réalisé du « seed money », ou capital amorçage, pour de nombreuses chaînes TV thématiques. Pour le reste nous intervenions le plus souvent en consortium. Peu importait au final que nous soyons minoritaires ou majoritaires, l’essentiel c’est encore d’être leader
sur le projet et sa réalisation, de sa naissance jusqu’à notre sortie du capital. A nouveau, notre approche industrielle apportait une vision particulièrement pertinente sur les sorties et nous a offert quelques beaux succès.
Notre atout était véritablement notre approche de spécialistes, ce qui nous permettait de compenser une moindre compétence technique sur certaines opérations. Aujourd’hui, ce serait sans doute plus difficile car d’une part il y a plus de concurrence et d’autre part les montages financiers sont donc plus complexes et plus sophistiqués.
Le métier n’était pas normé comme il l’est devenu aujourd’hui.
Les premiers outils qui ont été développés étaient des outils de gestion de portefeuilles non cotés. A l’époque, le tâtonnement était un peu de mise et chacun confrontait ses expériences : nous avons par exemple fait venir un financier, puis un homme de l’un des métiers sur lesquels nous étions spécialisés. Mais même sur le volet financier, les montages restaient très simples et il s’agissait moins de modèles de risque que de business models relevant plus de l’évaluation de bon sens a posteriori. Il ne s’agit pas de dire que nous étions moins rigoureux. Notre approche était simplement plus industrielle. Nous fondions notre appréciation des business models sur la base de confrontations avec des réseaux très importants de chercheurs travaillant sur ces nouveaux développements technologiques, notamment des chercheurs appliqués, réseaux de compagnons d’école ou d’anciennes expériences professionnelles.
Il ne faut également pas du tout négliger l’effet de l’expérience acquise à financer les projets sur ces marchés spécialisés. Une fois que l’on s’est déjà investi dans une société, on est connu du secteur. Les montages quant à eux se font de moins en moins empiriquement : si chaque investissement avait son propre échéancier, au bout de 10 ans nous avions consolidé un corpus que nous étions capables de réutiliser régulièrement.
Ayant pris dès leur origine les vagues technologiques (téléphonie mobile, télévision numérique), économique (généralisation du modèle de « private equity ») et politique (libéralisation), nous avons pu surfer sur les privatisations, en particulier dans la téléphonie mobile. Nous nous sommes ainsi retrouvés actionnaires de 17 opérateurs mobiles dans le monde, dont une douzaine dont nous étions fondateurs. Dès le début des années 1990, les affaires avaient véritablement décollé. Tout allait très vite et il y avait de plus en plus d’opportunités d’investisseurs et d’investissements.
Notre renommée dans le secteur de la communication dépassant les frontières, de plus en plus de propositions internationales affluaient. La création d’une filiale spécialisée de CDC Participations, Part’Com, a permis le lancement d’un autre fonds, plus international, permettant d’attirer des investisseurs internationaux. Nous avons ainsi pu aller au Canada, en Belgique, en Slovénie, en Hongrie… Nous avons même pu participer à la licence 3 de téléphonie mobile (E+) en Allemagne, pour 2 %, en nous en sortant bien. Les sommes de l’époque n’étaient pas extravagantes. Nous sortions avant l’équilibre, en réalisant des multiples entre 5 et 15.
La croissance de l’activité m’a également permis de développer une équipe, sur un rythme moyen d’un nouveau collaborateur par an. Ce moment est délicat dans tout métier, mais particulièrement dans le capital investissement. Ce sont en effet d’abord les hommes qui comptent pour garantir la bonne croissance d’une telle structure : de bonnes compétences professionnelles, mais aussi un bon équilibre psychologique, un comportement ouvert et humble. Nous identifiions les profils et les faisions valider par un cabinet, lequel revoyait chaque collaborateur une fois par an. Cela a permis de garantir une bonne stabilité des effectifs, de sorte que nous cumulions plus de 200 années d’expérience au début des années 2000 sur une quinzaine de collaborateurs.
Retour d’expérience
En trente ans, le capital investissement a profondément évolué. Intuitive à ses débuts, la profession s’est normée, régulée et complexifiée. Elle est devenue technique, mais reste un métier formidable par la diversité des cas que l’on rencontre. On peut, comme je l’ai fait, voir 200 entreprises en 18 ans de carrières, faire face à des critiques dont certaines font sourire a posteriori et participer au développement de l’innovation.
Et il faut toujours une certaine dose de flair et d’intuition. A l’apparition du GSM, par exemple, les gens m’attaquaient à propos de la création de SFR : « Qu’est ce qui vous permet de croire qu’il y aura en France 4 millions d’abonnés en 2000 ? ». On découvre sans cesse des choses plus ou moins farfelues. C’est à la fois stressant et excitant et on peut gagner quand on fait preuve d’intelligence. Notre métier est au final utile puisque nous avons permis l’avènement rapide de la plupart des chaînes TV thématiques et de la majorité des débouchés marchands des nouvelles technologies.
Henri de Lapparent (1964) est président du conseil de surveillance d’Iris Capital Management





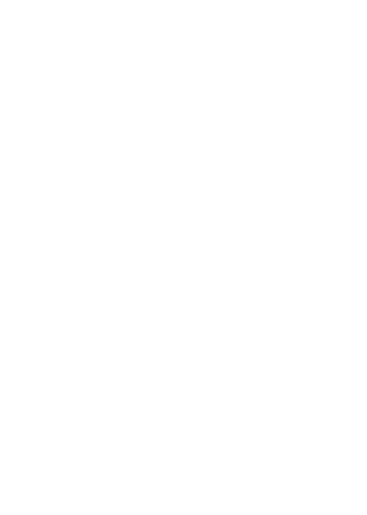
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.